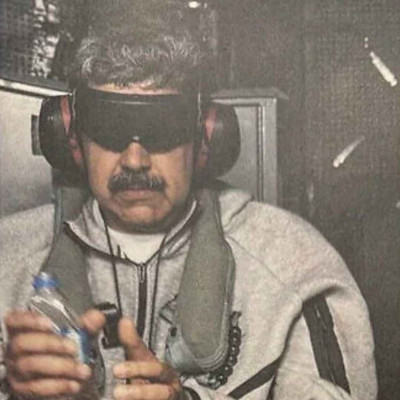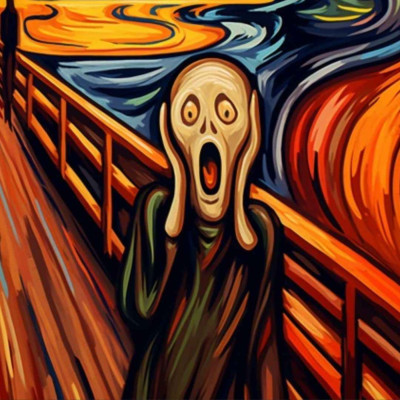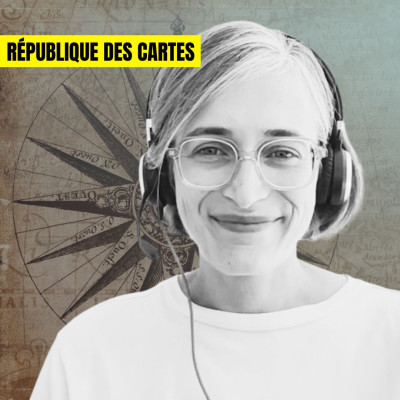Après vous avoir parler de mes peurs, je vous parle d'espoir :
L'espoir comme une réponse à la peur.
La place de l'espoir dans la philosophie et les religions
Quoi faire de l'espoir à notre époque ?
Dans #PAUSE, Julien prend la parole seul pour partager des réflexion sur les interviews, sur des lectures ou des éléments d'actualité. Le but est toujours le même : progresser vers une meilleur connaissance des grands tremblements de notre époque et de ce qui les structure.
Soutenez Sismique
Sismique existe grâce à ses donateurs. Aidez-moi à poursuivre cette enquête en toute indépendance.
Merci pour votre générosité ❤️
Nouveaux podcasts
Opération Venezuela : le retour des empires | #PAUSE
Opération Absolute Resolve, Trump et la fin de l’ordre libéral. Comprendre la nouvelle grammaire de la puissance à la suite de l'opération "Résolution absolue".
Vivant : l’étendue de notre ignorance et la magie des nouvelles découvertes
ADN environnemental : quand l'invisible laisse des traces et nous révèle un monde inconnu.
Les grands patrons et l'extrême droite. Enquête
Après la diabolisation : Patronat, médias, RN, cartographie d’une porosité
Géoconscience et poésie littorale
Dialogue entre science, imagination et art autour du pouvoir sensible des cartes
Violence sur nos écrans : la banalisation du mal
Pourquoi la violence ne nous choque plus comme avant ? Quelles conséquences pour la société ? Enquête sur l’usure émotionnelle des images et la banalisation de la violence
France, Europe, Big Tech : Le prix du renoncement
Thierry Breton raconte les erreurs du passé et les rapports de force d’aujourd’hui.
L’envers de la carte. Entre information, narration et pouvoir
Comprendre les choix derrière chaque carte et infographie, avec Clara Dealberto
STEVE BANNON : Le plan du stratège du populisme mondial
Au cœur de la vision illibérale qui redessine le monde occidental