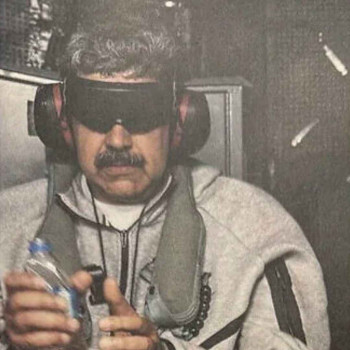Operation Absolute Resolve, Trump et la fin de l’ordre libéral. Comprendre la nouvelle grammaire de la puissance à la suite de l'opération "Résolution absolue".
Le 3 janvier 2026, les États-Unis enlèvent le président vénézuélien Nicolás Maduro lors d’une opération militaire éclair. L’événement sidère, choque, divise. Certains y voient la chute d’un narco-État, d’autres un retour assumé à l’impérialisme le plus brutal.
Mais si l’on s’arrête à l’indignation ou à l’approbation morale, on passe à côté de l’essentiel.
Cet épisode ne parle pas seulement du Venezuela. Il parle de la transformation accélérée de l’ordre mondial. De la fin assumée du multilatéralisme. Du retour des logiques d’empire, de sphères d’influence et de rapports de force nus. De l’énergie, des ressources, de la monnaie, et de la peur du déclin qui structure désormais la vision du monde de Washington et de ses adversaires.
Dans cet épisode, je propose de prendre du recul pour comprendre ce que cette opération révèle vraiment : une nouvelle grammaire de la puissance, les contradictions de la stratégie américaine, ce que cela autorise au reste du monde, et pourquoi l’Europe se retrouve plus que jamais marginalisée.
Le Venezuela n’est peut-être pas une exception. Il pourrait bien être le premier acte d’un monde qui change beaucoup plus vite qu’on ne veut l’admettre.
1. Changement de cadre, pas simple événement
L’enlèvement de Maduro n’est pas un accident tactique mais un signal stratégique : il révèle une mutation profonde de l’ordre international.
L’analyse gagne à distinguer l’événement, la tendance de fond et la structure du système mondial.
2. Fin assumée du vernis libéral
Les États-Unis n’abandonnent pas l’empire : ils cessent de le justifier par le droit, la démocratie ou le multilatéralisme.
La puissance ne cherche plus l’autorité normative ; elle s’exerce directement, sans médiation juridique crédible.
3. Peur du déclin comme moteur idéologique
La stratégie trumpienne est structurée par l’angoisse du déclassement : économique, géopolitique, monétaire et civilisationnel.
Le droit international est perçu non comme une protection, mais comme une contrainte qui handicape les puissances libérales.
4. Monde pensé en sphères d’influence
Le monde est désormais lu comme un ensemble de zones à contrôler, hiérarchisées selon leur valeur stratégique.
L’hémisphère occidental est considéré comme un espace vital non négociable pour Washington.
5. Criminalisation du politique
Qualifier un chef d’État de « criminel » permet de contourner le droit de la guerre et de délégitimer la souveraineté.
Ce mécanisme crée un précédent dangereux, facilement réplicable par d’autres puissances.
6. Ressources et énergie comme déclencheurs centraux
Le Venezuela illustre le retour des ressources (énergie, infrastructures, minerais) comme piliers de la puissance.
Il s’agit moins de « prendre le pétrole » que d’empêcher l’adversaire d’en contrôler l’accès.
7. Une stratégie efficace mais fragile
Décapiter un régime est rapide ; stabiliser un pays fragmenté est long, coûteux et incertain.
La doctrine privilégie le choc initial et la délégation, au risque d’un chaos durable.
8. Tensions internes aux États-Unis
La politique étrangère devient un instrument de politique intérieure, fondé sur l’urgence et la personnalisation du pouvoir.
À court terme mobilisateur, ce choix fragilise les contre-pouvoirs et accroît les risques de backlash.
9. Effet d’exemple mondial
L’intervention américaine abaisse le seuil psychologique de l’action unilatérale.
Russie, Chine et puissances régionales voient leurs propres logiques de force implicitement validées.
10. Marginalisation stratégique de l’Europe
L’Union européenne reste attachée aux règles dans un monde qui ne les respecte plus.
Sans puissance militaire, énergétique et industrielle intégrée, le droit devient un discours sans levier.
11. Un nouvel ordre en formation rapide
Le monde bascule vers un système plus fragmenté, transactionnel et conflictuel.
La monnaie, l’IA, les ressources critiques et les rivalités sino-indiennes seront des champs décisifs à court terme.
12. Le vrai enjeu : comprendre la structure
L’essentiel n’est pas l’événement spectaculaire, mais la grammaire de pouvoir qu’il révèle.
Lire le monde exige désormais de combiner idées, histoire et matérialité des rapports de force.
Doctrines et cadres stratégiques évoqués
Doctrine Monroe / “Donroe Doctrine”
Principe selon lequel l’hémisphère occidental constitue une zone d’intérêt vital exclusive pour les États-Unis. Dans sa version trumpienne, elle ne vise plus seulement l’exclusion des puissances extérieures, mais l’affirmation directe d’une prérogative impériale.Stratégie de sécurité nationale américaine (décembre 2025)
Document de référence qui formalise la priorité donnée à l’hémisphère occidental et à l’Indo-Pacifique, au détriment d’un engagement global fondé sur le multilatéralisme.Sphères d’influence
Vision du monde où les grandes puissances se voient reconnaître, explicitement ou implicitement, des zones de contrôle privilégiées, au détriment de la souveraineté formelle et universelle des États.
Concepts politiques et géopolitiques mobilisés
Logique impériale
Conception de la puissance fondée sur le contrôle des territoires, des ressources et des routes stratégiques, assumée sans justification universaliste.Criminalisation du politique
Usage du droit pénal (narco-terrorisme, criminalité transnationale) pour délégitimer un pouvoir en place et contourner les cadres classiques du droit international et du droit de la guerre.Primauté de l’efficacité sur la légitimité
Basculement d’un ordre fondé sur la conformité juridique vers un ordre fondé sur la capacité à produire des faits accomplis rapidement.Souveraineté conditionnelle
Idée implicite selon laquelle la souveraineté n’est plus un droit garanti, mais un statut dépendant de la capacité à la défendre face aux puissances dominantes.
Géopolitique des ressources et de l’énergie
Contrôle stratégique des ressources
Logique visant moins l’exploitation directe que l’empêchement de l’accès des adversaires à des ressources clés (pétrole, minerais, infrastructures).Énergie comme levier géopolitique
Le pétrole et les infrastructures énergétiques sont abordés comme des instruments de pouvoir et de projection stratégique, et non comme de simples biens économiques.Rareté relative et tension systémique
Idée que la conflictualité contemporaine est exacerbée par la perception d’une raréfaction des ressources stratégiques dans un monde fragmenté.
Ordre international et normes
Érosion de l’ordre international libéral
Affaiblissement des règles, institutions et mécanismes de régulation hérités de l’après-1945, non seulement par contestation externe, mais par contournement interne.Retour de la logique westphalienne
Réaffirmation d’un ordre fondé sur les rapports de force et la reconnaissance pragmatique des puissances, plutôt que sur des normes universelles contraignantes.
Dynamiques systémiques évoquées
Autorisation implicite
Le fait qu’une action menée par une grande puissance abaisse le seuil de ce qui devient acceptable pour les autres acteurs du système international.Contagion stratégique
Processus par lequel une méthode d’action (intervention unilatérale, changement de régime, fait accompli) tend à se diffuser dans un système dérégulé.Marginalisation stratégique de l’Europe
Situation d’un acteur attaché aux normes, mais dépourvu des moyens matériels et politiques pour les faire respecter dans un monde de rapports de force.
Souveraineté, exception et monde conflictuel
Carl Schmitt — La notion de politique
Texte fondamental pour comprendre la lecture du monde en termes d’ami / ennemi et la conception conflictuelle du politique qui sous-tend le retour des sphères d’influence.
https://www.babelio.com/livres/Schmitt-La-notion-de-politique/42031Carl Schmitt — Théologie politique
Ouvrage clé sur la notion d’exception et sur l’idée que le souverain est celui qui décide en situation de crise — un cadre de lecture très éclairant pour comprendre la pratique contemporaine du pouvoir.
https://www.babelio.com/livres/Schmitt-Theologie-politique/42030Giorgio Agamben — État d’exception
Une mise en perspective contemporaine de Schmitt : comment l’exception devient un mode normal de gouvernement dans les démocraties modernes.
https://www.babelio.com/livres/Agamben-Etat-dexception/42018
Penser le retour des empires et des sphères d’influence
Henry Kissinger — World Order
Une analyse structurante des fondements des ordres internationaux, de l’équilibre des puissances et de l’érosion du cadre libéral.
https://www.babelio.com/livres/Kissinger-World-Order/631147John J. Mearsheimer — The Tragedy of Great Power Politics
Le réalisme offensif appliqué aux grandes puissances : pourquoi la domination régionale est une logique structurelle, pas idéologique.
https://www.babelio.com/livres/Mearsheimer-The-Tragedy-of-Great-Power-Politics/42287
Empire, puissance et fin du vernis libéral
Niall Ferguson — Colossus: The Rise and Fall of the American Empire
Une lecture critique de l’empire américain, de sa réticence à s’assumer comme tel et de ses contradictions internes.
https://www.babelio.com/livres/Ferguson-Colossus/12365Stephen Wertheim — Tomorrow, the World
Sur le moment précis où les États-Unis ont fait le choix de la suprématie globale plutôt que du simple équilibre.
https://www.babelio.com/livres/Wertheim-Tomorrow-the-World/1328845
Ressources, énergie et matérialité de la puissance
Vaclav Smil — Energy and Civilization
Pour replacer l’énergie au cœur des dynamiques de civilisation et de puissance sur le temps long.
https://www.babelio.com/livres/Smil-Energy-and-Civilization/1005217Daniel Yergin — The New Map
Une lecture contemporaine des liens entre énergie, sécurité et rivalités géopolitiques.
https://www.babelio.com/livres/Yergin-The-New-Map/1244203
Monnaie, ordre économique et fragmentation
Barry Eichengreen — Exorbitant Privilege
Pour comprendre les fondements du pouvoir monétaire américain et les scénarios de remise en cause du dollar.
https://www.babelio.com/livres/Eichengreen-Exorbitant-Privilege/232232
Adam Tooze — Shutdown
Sur la fragilité systémique du capitalisme global et la politisation croissante des instruments financiers.
https://www.babelio.com/livres/Tooze-Shutdown/1361928
Articles intéressants
https://www.capitaleconomics.com/blog/us-intervenes-venezuela-economic-and-geopolitical-implications
https://time.com/7343019/venezuela-trump-oil-china/
https://ageoftransformation.org/venezuelas-collapse-is-a-window-into-how-the-oil-age-will-unravel/
L’arrestation de Nicolás Maduro par les forces américaines, au terme d’une opération militaire éclair menée le 3 janvier 2026, a provoqué une onde de choc mondiale. Les réactions ont été immédiates, souvent excessives, presque toujours polarisées. Pour les uns, il s’agirait d’un acte de libération face à un régime autoritaire et à un narco-État responsable de l’effondrement d’un pays et de l’exode de millions de personnes. Trump dans ce cadre reste presque candidat au prix nobel de la paix. Pour les autres, cette opération marque une violation brutale du droit international, un retour assumé à l’impérialisme de canonnière, et un précédent extrêmement dangereux.
Ces réactions à chaud ont un point commun : elles restent prisonnières de l’événement lui-même. Elles s’arrêtent au quoi (l’enlèvement d’un chef d’État) sans vraiment interroger le pourquoi, le comment, et surtout le ce que cela révèle de l’état du monde dans lequel nous entrons. Car si l’intervention américaine au Venezuela est spectaculaire, elle n’est pas intelligible si on la réduit à une affaire vénézuélienne. Ce qui se joue ici dépasse largement Caracas, Maduro ou même l’Amérique latine. Nous sommes face à un moment de clarification.
Pour la première fois depuis longtemps, les États-Unis n’ont même pas cherché à dissimuler leur action derrière un discours universaliste. Pas de mise en scène humanitaire élaborée, pas de grand récit multilatéral. Le message délivré depuis Mar-a-Lago est d’une franchise presque brutale : il est question de puissance, de sécurité, de contrôle, d’ordre. Autrement dit, ce que révèle le Venezuela, ce n’est pas seulement une rupture juridique ou diplomatique. C’est l’affirmation explicite d’une vision du monde où la force prime à nouveau sur la norme, où les règles ne valent que tant qu’elles servent les intérêts de ceux qui ont les moyens de les imposer.
Dans ce cadre, le Venezuela devient un cas d’école : un État affaibli, riche en ressources, stratégiquement situé, politiquement isolé, et perçu comme un maillon faible dans une compétition globale qui dépasse largement son propre destin. C’est pour cette raison que je vous propose de prendre du recul. Non pas pour juger à chaud, même si de fait c’est tout frais, mais pour comprendre ce que cet épisode dit des logiques profondes à l’œuvre : des visions du monde, des rapports de force matériels, des peurs, et des trajectoires de long terme. Parce que ce qui se joue ici n’est peut-être pas un simple épisode de plus dans l’histoire des relations internationales, mais l’un de ces moments où un ordre cesse de prétendre à l’universalité… et commence à assumer pleinement sa nature conflictuelle.
I. Idéologie et vision du monde : le retour assumé de la logique d’empire
Pour comprendre l’opération américaine au Venezuela, il faut commencer par là : par la vision du monde qui la rend possible. Ce qui se joue ici n’est pas une improvisation tactique, ni un simple excès de style trumpien. C’est l’expression décomplexée d’une idéologie ancienne, réactivée par un sentiment de déclin et par l’effondrement progressif de l’illusion d’un ordre libéral universel.
Il faut d’abord rappeler une chose, souvent oubliée en Europe : les États-Unis n’ont jamais réellement renoncé à une logique impériale. Dès 1823, la doctrine Monroe posait un principe limpide : l’hémisphère occidental constitue une zone d’intérêt vital, fermée aux ingérences extérieures et placée, de fait, sous tutelle américaine. Ce principe a structuré toute la politique étrangère américaine au XXᵉ siècle : interventions militaires, coups d’État, pressions économiques, opérations clandestines. Après 1945, cette logique n’a pas disparu ; elle a été recouverte par le langage du multilatéralisme, du droit international et des institutions. Un vernis, plus qu’une rupture. Entre 1945 et 1991, en pleine guerre froide, les États-Unis ont tenté environ soixante-dix renversements de régime et en ont réussi une vingtaine: Iran en 1953, Guatemala en 1954, Chili en 1973, Panama en 1989 pour ne citer que les plus connus. Et cette intolérance à la contestation de leurs intérêts ne s’est jamais réellement éteinte depuis.
Ce qui change aujourd’hui n’est donc pas la nature de la puissance américaine, mais son rapport au récit. Pendant des décennies, Washington a cherché à transformer sa puissance brute en autorité normative : agir au nom du droit, de la démocratie, de la liberté. Cette capacité à universaliser ses intérêts constituait le cœur de l’ordre libéral.
L’intervention au Venezuela marque une rupture nette. Trump ne cherche plus à convaincre ni à justifier. Il assume. L’empire ne se dissimule plus derrière des procédures : il s’exerce à découvert. Le message est simple, presque brutal : la force précède le droit — et quand on parle de droit, il s’agit du droit américain, le seul qui compte.
Pourquoi ce changement de ton, ce changement de méthode ? Parce qu’une partie de l’Amérique est traversée par une peur profonde : la peur du déclassement. Peur économique, peur géopolitique, peur monétaire, peur démographique.
Dans la vision trumpienne, les États-Unis sont une puissance menacée : par la montée de la Chine, par l’érosion du dollar comme monnaie hégémonique, par la fragmentation du commerce mondial, par l’épuisement des ressources faciles, et par ce qui est perçu comme une naïveté occidentale face à des adversaires qui, eux, ne se contraignent pas.
Dans ce cadre mental, le droit international n’apparaît plus comme une protection — même lorsqu’il est structurellement favorable aux États-Unis — mais comme une contrainte asymétrique. Il limiterait les puissances libérales tout en laissant les mains libres à celles qui s’en affranchissent.
La conclusion devient alors presque mécanique : si les règles ne protègent plus, il faut les contourner. Trump formule ainsi, de manière implicite mais constante, une rupture stratégique majeure : la stratégie du droit ne fonctionne plus. Elle n’aurait empêché ni la guerre en Ukraine, ni l’expansion chinoise, ni la désindustrialisation occidentale, ni la perte de contrôle migratoire. Dès lors, l’usage direct de la force redevient non seulement acceptable, mais nécessaire.
Cette vision s’inscrit dans une lecture profondément conflictuelle, presque civilisationnelle, des relations internationales. Le monde n’est plus pensé comme un espace régi par des normes communes, mais comme un champ de rivalités entre blocs, entre puissances, entre visions irréconciliables.
On retrouve ici une logique très proche de celle de Carl Schmitt : le politique se définit par la distinction entre l’ami et l’ennemi. Dans cette perspective, la coopération est toujours provisoire, contingente ; la conflictualité est structurelle. Les États-Unis n’ont donc pas vocation à défendre un ordre universel, mais à préserver leur sphère vitale.
Le Venezuela, dans ce schéma, n’est pas un problème moral ou humanitaire. C’est un espace stratégique mal contrôlé, infiltré par des acteurs hostiles, riche en ressources, situé dans une zone considérée comme intérieure à l’empire américain. Son existence même, en tant qu’État souverain opposé à Washington, devient une anomalie.
Un élément clé de cette nouvelle grammaire impériale, souvent sous-estimé, est la criminalisation du politique. En qualifiant Nicolás Maduro de « narco-terroriste », les États-Unis opèrent un glissement décisif : ils ne reconnaissent plus un adversaire étatique, mais un criminel relevant du droit pénal américain.
Ce mécanisme est redoutablement efficace. Il permet de contourner le droit de la guerre, de délégitimer la souveraineté adverse, de transformer une intervention militaire en opération de police internationale, et surtout de créer un précédent facilement exportable.
Si la souveraineté devient conditionnelle, révocable au nom de la criminalité, alors aucun État n’est véritablement à l’abri. Ce que Washington s’autorise aujourd’hui, Moscou, Pékin ou Ankara pourront s’autoriser demain, avec leurs propres définitions du crime. C’est déjà, d’une certaine manière, ce que fait Israël dans son voisinage.
Enfin, il faut être très clair : le Venezuela n’est pas un cas isolé. Il joue le rôle d’acte fondateur. La mise en scène de Trump à Mar-a-Lago, la référence explicite à la doctrine Monroe, les menaces de seconde vague, l’élargissement immédiat aux questions du Groenland, du Panama ou de Cuba : tout indique que nous sommes face à une stratégie, pas à une réaction ponctuelle.
L’idéologie est désormais lisible : le monde est dangereux, les règles sont obsolètes, la puissance doit être réaffirmée, et l’hémisphère occidental doit être verrouillé. Qu’on l’approuve ou qu’on la condamne, cette vision constitue le socle sur lequel s’articulent toutes les autres dimensions de l’intervention américaine.
La question suivante s’impose donc presque naturellement : comment cette idéologie se traduit-elle concrètement ? Quels sont les leviers matériels de cette stratégie ?
C’est ce que nous allons examiner dans la suite.
II. Les atouts de la puissance : territoire, force, énergie, ressources
Une fois la vision du monde posée, il faut regarder ce qui la rend opérante. Car l’intervention américaine au Venezuela ne repose pas seulement sur une idéologie : elle s’appuie sur une lecture très concrète de ce qui fait encore la puissance des États-Unis aujourd’hui.
D’abord, le territoire.
Dans la manière dont Trump et son entourage pensent le monde, la planète n’est pas un espace homogène régi par des règles communes, mais une carte hiérarchisée. Certaines zones sont vitales, d’autres secondaires, d’autres enfin négociables. Et l’hémisphère occidental appartient clairement à la première catégorie.
Ce raisonnement n’a rien de nouveau dans l’histoire américaine. Mais il est désormais assumé comme tel. Le Venezuela, comme le canal de Panama, les Caraïbes ou le Groenland, n’est pas perçu comme un État parmi d’autres, mais comme un point stratégique situé dans un espace que Washington considère comme son environnement immédiat. Dans cette logique, laisser s’installer une influence hostile, chinoise, russe ou autre, devient inacceptable, non pas au nom d’un principe abstrait, mais pour des raisons de sécurité, de contrôle des flux et de profondeur stratégique.
Cette vision du monde par zones vitales rapproche les États-Unis de leurs adversaires bien plus qu’on ne le dit souvent. Elle les place sur le même terrain mental que la Russie avec son “étranger proche” ou que la Chine avec sa périphérie maritime. La grande rupture n’est donc pas tant doctrinale que discursive : ce raisonnement, auparavant maquillé sous un langage universaliste comme on l’a dit, est désormais formulé sans détour.
https://www.youtube.com/watch?v=fyTj2jFdUMI
2:25 ”Notre domination de l’emisphere occidentale ne sera plus jamais contestée, ça n’arrivera plus”.
we need greenland: https://www.youtube.com/watch?v=R8Q-0EcYuds
“Nous avons besoin du Groenland, pour des raisons de sécurité nationale.”
À cette logique territoriale s’ajoute la force militaire, mais sous une forme profondément transformée. L’opération vénézuélienne n’a rien d’une invasion classique. Elle illustre une doctrine forgée dans l’échec des guerres longues du début du XXIᵉ siècle. Il ne s’agit plus d’occuper, de reconstruire ou de démocratiser, mais de frapper vite, de neutraliser les centres de pouvoir et de sécuriser quelques points clés, en laissant le reste volontairement flou.
C’est une puissance de démonstration autant que de contrainte. Elle vise les adversaires extérieurs, mais aussi les alliés, les opinions publiques et les contre-pouvoirs internes. Elle dit une chose simple : les États-Unis conservent la capacité d’agir rapidement, unilatéralement, et de modifier un rapport de force sans s’enliser. Ce n’est pas une promesse de stabilité, c’est une promesse d’efficacité, en tout cas pour l’instant. On verra les choix qui seront faits, mais il semble que ce soit l’approche choisie.
Vient ensuite la question de l’énergie et des ressources, sans doute la plus commentée et la plus mal comprise. L’intervention américaine ne s’explique pas par un besoin direct de pétrole vénézuélien pour alimenter le marché intérieur. Elle s’inscrit plutôt dans une logique de contrôle stratégique, dans un monde où l’énergie, les minerais et les infrastructures redeviennent des instruments centraux de puissance. Les ressources ont toujours été clés, mais à une époque de raréfaction, la tension monte.
Le Venezuela concentre plusieurs éléments clés : des réserves gigantesques, des ports, des infrastructures certes dégradées mais stratégiques, et une position géographique stratégique. Laisser ce pays durablement dans l’orbite chinoise ou russe revient, pour Washington, à accepter un recul dans une zone considérée comme essentielle.
Entre 2023 et 2025, la Chine absorbait entre 55% et 80% des exportations pétrolières du Venezuela certains mois, et tout comme la Russie, elle a investit dans des infrastructures locales sous différentes formes. D’après le New York Times, le Vénézuela doit encore l’équivalent de 10 milliards de dollars à la Chine en pétrole pour rembourser sa dette. Dans ce cadre, il s’agit autant d’empêcher l’adversaire d’accéder à ces ressources que d’en tirer un bénéfice direct.
C’est là que se dessine ce que Trump a lui-même résumé comme une forme de trinité de la puissance : 3:01 : https://www.youtube.com/watch?v=fyTj2jFdUMI ”Le futur sera determiné par notre habilité à protéger le commerce, les territoires, les ressources qui sont clé pour la sécurité nationale”
le commerce, le territoire et les ressources donc. Le droit, les alliances et les normes n’ont pas disparu, mais ils ne sont plus structurants. Ils deviennent des instruments secondaires, mobilisés quand ils servent les intérêts, ignorés lorsqu’ils les entravent.
Le Venezuela s’inscrit pleinement dans cette logique. Non comme une exception, ni comme une improvisation, mais comme un acte cohérent dans une stratégie plus large de reconquête de leviers matériels, dans un monde perçu comme de plus en plus conflictuel et fragmenté.
Reste alors la question centrale, celle que l’idéologie et la démonstration de force ne suffisent pas à résoudre : cette stratégie peut-elle produire autre chose qu’un choc initial ? Peut-elle déboucher sur un contrôle durable, ou risque-t-elle au contraire d’ouvrir une séquence d’instabilité incontrôlable ?
C’est cette question, et les limites internes de la stratégie américaine, que j’aborde maintenant.
III. Une stratégie sous tension : risques, angles morts et retours de flamme
À ce stade, une chose apparaît nettement : la stratégie américaine n’est ni improvisée ni incohérente. Elle repose sur une vision claire du monde, sur des moyens encore considérables, et sur une volonté assumée de rompre avec les contraintes du passé. Mais précisément parce qu’elle est assumée, elle expose aussi ses failles.
La première tient au terrain lui-même.
Décapiter un régime est une chose. Gérer ce qui suit en est une autre. L’histoire récente est remplie d’exemples où la victoire tactique a ouvert sur un vide stratégique. Le Venezuela est un pays épuisé, fragmenté, traversé par des loyautés concurrentes, des réseaux criminels, des forces armées politisées et une société civile profondément abîmée. Penser que l’effondrement du sommet suffira à produire un ordre stable relève au mieux d’un pari, au pire d’un déni.
Or la doctrine trumpienne, telle qu’elle se dessine ici, n’a pas pour cœur la reconstruction. Elle privilégie la rapidité, la coercition et la délégation. L’administration américaine semble peu disposée à investir du capital politique, financier et humain dans une transformation en profondeur du pays. Le risque est donc celui d’un État maintenu dans une instabilité chronique : trop faible pour menacer directement les intérêts américains, mais trop désorganisé pour redevenir un acteur souverain et prévisible.
Cette instabilité n’est pas seulement un problème moral ou humanitaire. Elle peut se retourner contre ceux qui l’ont provoquée. Flux migratoires, criminalité transnationale, radicalisation politique, pressions sur les États voisins : tout cela finit par revenir vers le centre, même quand on prétend agir au nom de la sécurité.
Le deuxième angle mort concerne la politique intérieure américaine.
L’intervention au Venezuela s’inscrit dans un contexte de polarisation extrême, de fragilisation des contre-pouvoirs et de personnalisation croissante du pouvoir exécutif. Elle renforce une dynamique déjà à l’œuvre : celle d’un président qui agit au nom de l’urgence, sans réel contrôle institutionnel, et qui transforme la politique étrangère en prolongement direct de sa stratégie domestique.
À court terme, cela peut fonctionner. Une démonstration de force extérieure soude une base, détourne l’attention des fractures internes et nourrit le récit d’un leadership fort. Mais à moyen terme, le risque est double. D’une part, celui d’une contestation croissante au sein même de l’appareil d’État, militaire, judiciaire ou administratif. D’autre part, celui d’une banalisation de l’exception, où chaque crise devient un prétexte à l’action unilatérale, jusqu’à l’épuisement du système.
La troisième limite est plus profonde encore.
Elle tient à une contradiction structurelle : cette stratégie repose sur une vision du monde fondée sur la force, alors même que les États-Unis affrontent des défis qui ne se résolvent pas par la coercition. Le changement climatique, la transition énergétique, les mutations technologiques, les déséquilibres sociaux internes ou encore la question monétaire ne peuvent pas être traités par des frappes ciblées ou des changements de régime.
Sur l’énergie, en particulier, le paradoxe est frappant. Le Venezuela est à la fois une puissance pétrolière potentielle et un symbole de l’épuisement d’un modèle. Son pétrole est coûteux, lourd, difficile à exploiter. Il renvoie à un monde où la domination énergétique passait par le contrôle de gisements, alors que l’avenir se joue aussi sur les chaînes de valeur technologiques, les métaux critiques, les infrastructures de transition et la capacité à organiser une sortie partielle des hydrocarbures.
Enfin, il y a le risque systémique : celui de l’effet d’exemple.
En agissant ainsi, Washington ne se contente pas de poursuivre ses intérêts. Il valide une grammaire d’action que d’autres peuvent reprendre. Criminaliser un dirigeant, intervenir sans mandat, redéfinir unilatéralement la souveraineté d’un État devient une option légitime dès lors que la puissance le permet.
Ce précédent affaiblit ce qui restait du cadre commun, non seulement pour les adversaires des États-Unis, mais aussi pour leurs partenaires. Et dans un monde où plusieurs puissances disposent désormais de moyens militaires, économiques et informationnels significatifs, cette logique ouvre la voie à une multiplication de crises simultanées, chacune justifiée au nom d’intérêts vitaux.
On va développer ça et passer de l’étude d’un cas particulier à une lecture plus globale. Parce que tout ça ne dit pas seulement quelque chose des États-Unis. Ca dit quelque chose de la trajectoire générale du système international.
IIV. Ce que cela autorise au reste du monde
À partir du moment où les États-Unis agissent ainsi, une ligne invisible est franchie. Ce n’est pas seulement une opération de plus dans une longue histoire d’interventions. C’est un changement de régime… mais appliqué à l’ordre international lui-même.
Quand la première puissance mondiale enlève un chef d’État étranger dans son chambre, avec sa femme, s’apprête à le juger sur son propre sol, prend le contrôle d’une partie d’un pays sans mandat international et sans même chercher à produire une justification juridique crédible, elle envoie un message très simple au reste du monde : il n’y a plus de plafond normatif. Il n’y a plus de règle supérieure qui s’impose aux rapports de force.
Ce message est entendu immédiatement, et surtout par ceux que Washington désigne depuis des années comme ses adversaires.
À Moscou, l’opération vénézuélienne ne ressemble pas à une provocation, mais à une confirmation. La Russie défend depuis longtemps une vision du monde fondée sur les sphères d’influence, la hiérarchie des puissances et la primauté de la force sur le droit. En agissant à Caracas, les États-Unis cessent de combattre cette vision et commencent à la pratiquer. La guerre en Ukraine, déjà présentée par le Kremlin comme une opération spéciale de “sécurisation” et de “libération”, se trouve rétroactivement normalisée. Si l’Amérique peut bombardé un pays souverain au nom de sa sécurité, sans déclaration de guerre, sans avoir été attaqué, pourquoi la Russie ne pourrait-elle pas redessiner ses frontières au nom de la sienne ? Qui viendra désormais lui donner des leçons ?
À Pékin, la leçon est tout aussi claire. La Chine observe depuis longtemps l’ordre international comme un système fondamentalement biaisé, conçu pour préserver la domination occidentale. En renonçant publiquement à cet ordre, Washington retire à Pékin l’un de ses principaux freins : la nécessité de ne pas apparaître comme le premier à rompre le cadre. Taïwan, dans ce contexte, cesse d’être une anomalie juridique délicate pour redevenir ce que la direction chinoise considère depuis toujours : une question de souveraineté et de rapport de force. Le précédent vénézuélien ne crée pas cette tentation, mais il en réduit considérablement le coût symbolique.
Ce mouvement dépasse largement les “grands” adversaires. Des puissances régionales, elles aussi, lisent très bien la séquence. La Turquie, Israël, l’Arabie saoudite, l’Iran ou même certains acteurs africains comprennent que le monde entre dans une phase où l’efficacité stratégique prime sur la légitimité, où la capacité à imposer un fait accompli compte davantage que la conformité aux règles. Dans un tel environnement, la retenue devient un handicap, pas une vertu.
Il faut bien mesurer ce que cela signifie : le Venezuela ne déclenche pas une chaîne de réactions mécaniques, mais il abaisse le seuil psychologique de l’action unilatérale. Il rend pensable ce qui ne l’était pas encore complètement. Il transforme l’exception en méthode.
C’est ici que le raisonnement devient inconfortable. Car si tout le monde peut désormais agir comme les États-Unis, alors les États-Unis cessent d’être une exception stabilisatrice. Ils deviennent un acteur parmi d’autres dans un monde où chacun teste les limites des autres. En cherchant à réaffirmer leur puissance, les États-Unis contribuent à rendre le système international plus instable, plus imprévisible, et donc potentiellement plus dangereux pour eux-mêmes.
Dans cet univers, la dissuasion ne repose plus sur le droit, mais sur la capacité à aller plus loin que l’autre. Et l’histoire montre que ce type d’équilibre est toujours fragile.
La question n’est donc pas seulement de savoir si cette stratégie fonctionne à court terme. La vraie question est de savoir quel monde elle fabrique. Un monde où la force fait loi n’est pas un monde plus sûr ; c’est un monde où chacun se prépare à frapper avant d’être frappé.
C’est dans ce contexte que la position européenne devient non seulement problématique, mais presque tragique.
V. L’Europe face au retour du monde réel
Alors j’ai déjà dédié un épisode au sujet de la perte de souveraineté européenne et je vous y renvoie en complément. Mais dans ce contexte on peut en dire quelques mots à nouveau.
Pour l’Europe, ce qui se joue au Venezuela est moins un choc qu’un révélateur. Encore un j’ai envie de dire tant ça devient tragi-comique. Le révélateur de son décalage stratégique avec le monde qui est en train d’émerger.
Depuis trente ans, l’Union européenne s’est construite sur une hypothèse implicite : celle d’un monde où la force recule, où le droit progresse, et où l’interdépendance économique rend la guerre à la fois coûteuse et inutile. Cette vision n’était pas naïve à l’origine. Elle était rationnelle dans un contexte précis : celui d’une hyperpuissance américaine garantissant la sécurité globale, et d’un ordre international relativement stable, même imparfait.
Mais ce monde n’existe plus. Et l’intervention américaine au Venezuela en est l’un des signes les plus clairs. C’est le dernier clou enfoncé dans le cercueil.
Face à cette opération, l’Europe ne réagit pas, non par lâcheté, mais par incapacité structurelle. Certains dirigeants ont tout de même rappelé leur attachement au droit international, exprimé leurs “préoccupations”, appelé à la retenue. Autrement dit, elle a parlé le langage d’un ordre qui n’est plus partagé par ceux qui font aujourd’hui l’histoire. A noter que notre président Macron ne s’est pas donné la peine de faire semblant de s’outrer. Je lis son tweet :
“Le peuple vénézuélien est aujourd’hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s’en réjouir.
En confisquant le pouvoir et en piétinant les libertés fondamentales, Nicolás Maduro a porté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple.” Il continue en disant que la transition doit être pacifique et qu’il assure la sécurité des français dans la région. Pas un mot sur la totale illégalité de l’opération. L’allégeance est totale. Bravo Donald, bien joué.
Mais dans le fond le problème n’est pas moral, il est stratégique. L’Europe continue de raisonner comme si les règles constituaient un bouclier. Or les règles ne protègent que ceux qui sont capables de les faire respecter. Et l’Union européenne, en tant qu’acteur géopolitique, ne dispose ni de la puissance militaire intégrée, ni de la cohérence politique, ni de l’autonomie énergétique et industrielle nécessaires pour peser dans un monde de rapports de force.
Ce décalage crée une situation paradoxale. Les européens voient très bien ce qui est en train de se passer, la fragmentation du monde, la logique des sphères, le retour de la coercition, mais ils n’ont ni les outils ni le consensus interne pour y répondre autrement que par le commentaire.
Pire encore, on se retrouve prise en étau. D’un côté, des États-Unis qui n’hésitent plus à imposer leurs choix, y compris au détriment de leurs alliés. De l’autre, des puissances autoritaires qui testent chaque jour les lignes rouges, précisément parce qu’elles savent que l’Europe n’a pas les moyens de les faire respecter.
Dans ce contexte, l’Europe n’est pas neutre. Elle est vulnérable. Vulnérable économiquement, par sa dépendance énergétique et technologique. Vulnérable militairement, par sa fragmentation. Vulnérable politiquement, par l’écart croissant entre ses principes affichés et sa capacité d’action réelle.
Le plus inquiétant, peut-être, est que cette vulnérabilité n’est pas encore pleinement assumée. Le discours européen continue de faire comme si le retour de la force était une anomalie temporaire, une parenthèse brutale avant un retour à la normale. Or ce que montre le Venezuela, c’est précisément l’inverse : la “parenthèse” était celle de l’après-guerre froide.
Nous entrons dans un monde où la sécurité prime sur la norme, où la puissance structure le droit, et où les alliances deviennent conditionnelles. Dans ce monde-là, ne pas choisir, ne pas investir dans la puissance, ne pas clarifier sa position, ce n’est pas rester au-dessus de la mêlée. C’est accepter de subir les choix des autres. Ainsi alors que Trump s’apprete à annexer le Groenland, le Danemark passe une nouvelle commande de F35 aux USA pour une valeur de 13 milliards de dollars.
Quelle crédibilité reste-t-il au vieux continent ? Déjà peu aimé dans le monde du fait d’un passé colonial encore dans les mémoires et d’une arrogance certaine, les européens s’enfoncent de manière pathétique. On était mal aimé, on est désormais méprisé.
L’Europe est donc face à un choix existentiel. Soit elle accepte d’être un espace régulé dans un monde dérégulé, confortable mais dépendant. Soit elle décide, enfin, de se doter des moyens de sa souveraineté réelle, au prix de renoncements, de conflits internes et d’une redéfinition profonde de son projet politique.
Ce choix n’est pas théorique. Il est déjà imposé par les faits. Personnellement je vous avoue que ça me désespère.
Conclusion
Allez je conclus.
Évidemment, tout n’a pas été dit. Et ce n’est pas un angle mort, c’est un choix.
Parce que face à des événements aussi spectaculaires que le Venezuela, le risque principal, ce n’est pas de manquer d’informations — c’est d’en avoir trop, trop vite, sans cadre pour les comprendre. L’enjeu, ce n’est pas de réagir à chaud, mais de prendre du recul, de comprendre les règles du jeu, les héritages historiques, les visions du monde qui s’affrontent… et la matérialité très concrète des rapports de force : l’énergie, les ressources, les routes, les territoires.
On a peu parlé de la monnaie, par exemple. Et pourtant, la question du dollar, de sa contestation progressive, de la montée en puissance des BRICS, des circuits financiers parallèles, est absolument centrale. Derrière les démonstrations militaires, il y a aussi une bataille silencieuse sur ce qui fait tenir l’ordre économique mondial et sur ce qui pourrait le remplacer.
On n’a pas non plus exploré en détail les conséquences politiques intérieures aux États-Unis. Les midterms approchent, et pour Trump, rien n’est gagné. Une démonstration de force extérieure peut consolider une base, mais elle peut aussi produire un retour de bâton, juridique, institutionnel ou électoral. Le Venezuela n’est pas seulement un signal envoyé au monde : c’est aussi un pari politique risqué à domicile.
Et puis il y a la question la plus inquiétante, et peut-être la plus simple : et maintenant ?
Après le Venezuela, quels seront les prochains points de friction ? Cuba, le Panama, le Groenland ? Jusqu’où cette logique d’affirmation hémisphérique peut-elle aller sans provoquer de réactions en chaîne incontrôlables ? Et comment les autres puissances, Chine, Russie, Inde, vont-elles ajuster leurs propres stratégies face à ce précédent ?
Ce qui est certain, c’est que nous sommes en train d’entrer très vite dans une nouvelle phase du monde. Un monde plus fragmenté, plus transactionnel, plus brutal dans ses logiques. Un monde où l’idéologie, la technologie, l’intelligence artificielle, les ressources critiques, et les rivalités entre grands pôles, notamment entre l’Inde et la Chine,vont structurer les rapports de force bien plus que les discours sur les valeurs.
Cette année, il va falloir regarder ces dynamiques ensemble, sans les isoler. Comprendre comment elles s’imbriquent. Comprendre ce qui change vraiment… et ce qui ne change jamais.
Parce que dans les périodes de bascule, ce n’est pas l’événement qui compte le plus.
C’est la structure qu’il révèle.
Soutenez Sismique
Sismique existe grâce à ses donateurs.Aidez-moi à poursuivre cette enquête en toute indépendance.
Merci pour votre générosité ❤️
Suggestion d'autres épisodes à écouter :
Souveraineté : l’Europe à genoux ?
Défense, énergie, technologie, économie… Les dangers de nos dépendances.
État de droit : comment les démocraties déraillent
Populisme, justice, démocratie : décryptage des glissements vers l’autoritarisme
Droit international : la fin d’une hypocrisie ?
Israël, USA, Iran, Gaza… Quand seule la force fait loi : le droit international est mort.
La guerre des ressources : géopolitique de l’extraction
Comprendre comment la bataille pour les ressources façonne les conflits, les alliances et nos futurs. Écologie ou puissance : faut-il choisir ?
Comment diminuer la violence ? Hobbes, Rousseau, Machiavel...
Penser la violence, le pouvoir et la paix sans naïveté
STEVE BANNON : Le plan du stratège du populisme mondial
Au cœur de la vision illibérale qui redessine le monde occidental
Violence : l'angle mort. Des mafias aux États, anatomie d'un système global
Comment les acteurs violents façonnent notre monde ? Au coeur des architectures oubliées. Partie 1/4
La nouvelle ère de la puissance brutale
Quand la morale ne compte plus : Trump, Musk, Netanyahou, Poutine & co... le retour de la puissance sans complexe.
Les dessous du projet Trump
Dans les coulisses de la transformation trumpienne de l'État
Peter Thiel, maître du jeu
Peter Thiel a un plan. Les démocraties en danger.... Suite de l'analyse de la révolution trumpienne en cours et de ses coulisses
Energie : le véritable nerf de la guerre
Quel lien entre l’énergie, le climat, l’économie, la puissance des nations et nos modes de vie ?La question de l’énergie est l’une des plus essentielle de notre époque, et pourtant elle est souvent incomprise, ou même simplement mise...