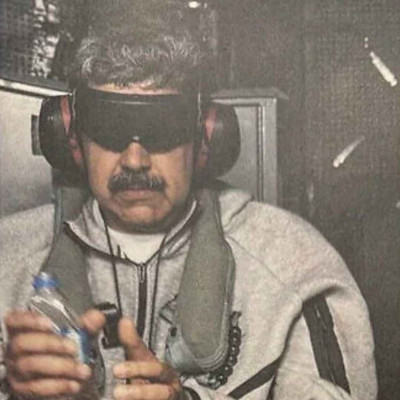Trump est-il fasciste ? La question peut sembler excessive, mais elle est essentielle pour comprendre notre époque.
Et pour y répondre, il faut revenir à l’histoire du fascisme, voir comment il a pris le pouvoir en Italie, en Allemagne et ailleurs, et identifier les logiques profondes qui se répètent aujourd’hui. Aux États-Unis, avec Trump. Mais aussi en Europe, où les droites radicales progressent et transforment le paysage politique.
Que faire ? Comment résister sans céder à la panique ni au déni ? Comment nommer les choses sans tomber dans l’exagération ? Et surtout : comment éviter que l’histoire ne se répète, sous d’autres formes ?
Une plongée dans l’histoire et dans les méandres du présent.
J’aimerais me tromper. Vraiment.
Depuis des mois, je me répète que je dramatise, que je vois trop noir.
Et pourtant, morceau après morceau, ce que j’observe autour de Trump ressemble bel et bien à une machine qui se met en place : un homme fasciné par la force, un manipulateur hors pair, un pouvoir qui se muscle pas à pas.
Pas un coup d’État à l’ancienne. Un glissement, un glissement prévisible, annoncé mais auquel peu ont voulu croire, malgré les alertes répétés. Un glissement auquel beaucoup ne veulent toujours pas croire, que l’on a du mal à nommer.
Et c’est précisément parce que ce n’est pas l’Italie de 1922 que c’est difficile à reconnaître. Certain attendent les bottes ; elles ne viennent pas.
On s’habitue, on se dit que ça va passer.
Et comprenez bien, Trump est certes une figure de premier plan qui attire notre regard, notamment parce que c’est un expert de la société du spectacle, mais derrière Trump, moins visible, moins “in your face”, c’est une tendance de fond que l’on retrouve aux 4 coins de globe, y compris, chez nous.
Je me méfie des mots qu’on jette trop vite : “fasciste”, “dictateur”, “tyran”, “nazi”… Ils ont été banalisés, ils caricaturent parfois, créent des polémiques stériles qui ne convainquent pas.
Pourtant si j’enlève l’étiquette et que je garde les faits : la haine comme ciment, l’État de droit grignoté, des organes de police qui se mutent comme milice, les boucs émissaires désignés et attaqués, le spectacle permanent qui écrase la vérité; alors l’image devient nette.
Ce n’est peut-être pas le fascisme d’hier, mais c’est bien de la même famille de logiques. On est dans une cousinade. Il y a un air de famille entre les ainés Benito, Adolf, Pol, Joseph et les petits Donald, Alice, Vladimir, Eric, Benjamin… des traits communs malgré des différences évidentes.
Et c’est souvent dans des moments qui paraissent anecdotiques que ces traits se dévoilent le plus clairement.
Il y a quelques jours seulement, le 22 septembre, aux USA : le mémorial de Charlie Kirk, ce militant influenceur jusque-là inconnu en Europe, devenu en une semaine une icône planétaire des droites extrêmes. Mémorial à grande échelle d’ailleurs diffusé sur des chaines françaises, comme si c’était la reine d’Angleterre à qui on rendait hommage. Trump, dans une cérémonie très religieuse dont les américains ont le secret, le consacre “martyr de la liberté”, avant de lâcher après que la veuve de Kirk eut pieusement et courageusement accordé son pardon au meurtrier.
“Moi, je hais mes adversaires, et je ne veux pas le meilleur pour eux.”
https://www.youtube.com/watch?v=pJzfp8QyiNw
Et la foule rit, acclame. Quelle figure sympathique ce Donald. Un frisson parcourt une partie du pays et au-delà : la haine affirmée comme punchline présidentielle. L’outrance à laquelle on s’est désormais hélas habitués, anesthésiés que nous sommes. Mais soyons clair, c’est le signal que les choses vont désormais s’accélérer en ce qui concerne les adversaire du grand chef…
JD Vance ajoute une couche presque messianique, on enterre une nouvelle idole.
Puis ABC suspend Jimmy Kimmel pour une blague anodine, la FCC menace de révoquer des licences, et déjà le cas Kirk est instrumentalisé pour justifier une pression accrue sur les opposants.
Une émotion transformée en arme politique, une figure mineure élevée en drapeau, et derrière : une mécanique de propagande, qui divise, qui désigne un adversaire, qui justifie, et qui prépare le terrain pour tenter d’aller toujours plus loin, toujours plus vite.
Et puis on surfe sur la vague Kirk.
150 000 personnes dans la rue à Londres, les slogans anti-immigration se mêlent aux violences de rue. Internet saturé d’extraits de joutes oratoires de saint Kirk qui pour le coup avait le courage de se frotter aux autres. Et la vengeance de Donald se précise. James Comey l’ancien patron du FBI qui avait enquêté sur les ingérences russes lors de la première élection de Trump, est inculpé. Erik Siebert procureur fédéral qui s’était opposé au président en refusant de poursuivre James Comey ainsi que la procureure générale de l’État de New York, est démissionné.
Les choses s’accélèrent.
Je parle des anglo-saxons, mais évidement la même houle est déjà là en Europe, avec une amplitude différente certes. Il faut dire que le terrain est fertile. Meloni qui parle de Dieu et de nation, Orbán en néo-dictateur, Simion qui rêve d’un empire roumain, le RN premier parti de France définitivement normalisé, le FPÖ à Vienne, Chega à Lisbonne.
Une onde de choc traverse l’Occident… Trump en est le fer de lance, Poutine souffle sur les braises, et tous les autres… Les démocraties partout sont en recul, malades, à risque.
Alors, comment appeler tout ça ?
Est-ce du fascisme, ou autre chose, un autre visage de l’autoritarisme ?
Est-ce une simple exagération rhétorique, ou le symptôme d’un basculement systémique ?
Et surtout : que gagne-t-on, ou que perd-on, à nommer ainsi ce que nous vivons ?
Voilà les questions que je me pose depuis quelques temps.
Je ne suis pas historien, je ne suis pas politologue. Mais je suis un citoyen qui regarde ces images, qui lit, qui écoute, et qui sent monter un gros malaise parce qu’il comprend soudain comment on avait pu laissé s’installer des dictatures à l’époque, sans broncher, voire en s’en.
Est-ce moi qui exagère, ou est-ce vraiment l’Histoire qui bégaye ?
Alors oui je sais on regarde beaucoup Trump et les USA en général, et j’en ai moi-même déjà beaucoup parlé.
Et oui, on sature, et oui, il y a plein d’autres sujets importants, plein d’endroits où il se passe des choses qui auront des répercussions sur notre avenir et je fais de mon mieux pour accorder mon attention à tout ça aussi, pour ne pas rester scotcher à l’actu.
Mais ce qui se passe sous nos yeux, au présent, est structurant pour la suite, pour les occidentaux en premier lieu. Parce que les USA sont la première puissance mondiale, et qu’en tant qu’européens nous dépendons d’eux, comme je l’ai expliqué en longueur dans mon épisode sur la souveraineté. Ils peuvent nous imposer leurs règles, leur culture et ils ne s’en privent pas.
Ce n’est pas simplement une suite d’évènements anodins, ce sont des lignes de failles essentielles, des points de rupture à surveiller de près.
Et j’y reviens donc, parce que notre capacité à répondre aux grands enjeux du monde diminue sérieusement si nos systèmes politiques continuent de sombrer et si l’occident continue de se fissurer de la sorte.
Alors fascisme ou non ? Dangereux ou non ?
1. Reconnaître le fascisme : un héritage mouvant
De quoi parle-t-on ? Quand on parle d’autoritarisme, de menace sur l’état de droit, l’histoire nous enseigne qu’il y a un paquet de nuances de gris.
Le fascisme n’est pas le seul à avoir eu pour conséquences des millions de morts. Le communisme en a fait d’ailleurs davantage et on pourra aussi parler des extrémismes religieux.
Mais dans cet épisode, on va parler du fascisme, parce qu’il s’agit d’observer les émergences actuelles de droite extrême. Qui se présentent d’ailleurs comme des remparts aux autres extrême, comme ça toujours été le cas dans l’histoire.
Alors, qu’est-ce qu’on entend vraiment par fascisme ?
Le mot est encore chaud, près d’un siècle après Mussolini et Hitler. Il déclenche immédiatement des images, des émotions, des réflexes pour peu qu’on ait un semblant de culture générale.
Pourtant, dès qu’on tente de le définir précisément, ça se brouille un peu.
Est-ce une idéologie cohérente, un régime politique, un style de pouvoir, une pathologie des démocraties ? Ou un peu tout cela à la fois ?
Alors j’ai fait mes petites recherches, élève zélé que je suis, parce que beaucoup ont déjà bien bossé le sujet. Voici donc quelque références clés.
Umberto Eco, en 1995 parlait d’un “fascisme éternel” ou “Ur-Fascism”. Une forme qui n’a pas de noyau doctrinal unique, mais des traits reconnaissables qui se répètent sous différentes couleurs. Pas besoin d’avoir toutes les cases cochées pour que l’alarme sonne. Ce qu’il listait, culte du chef, peur de l’étranger, mépris du droit, obsession de la pureté et de l’unité, transformation de la politique en lutte permanente, résonne étrangement quand on observe les États-Unis d’aujourd’hui. On va y revenir.
Robert Paxton, historien américain, lui, voyait le fascisme non pas comme une essence, mais comme un processus. Une dynamique qui se déploie en étapes : d’abord un mouvement qui se construit en marge, puis qui s’enracine en se nourrissant des frustrations sociales, qui conquiert le pouvoir avec l’aide d’élites effrayées, qui gouverne en sapant les institutions, et qui parfois, si les circonstances s’y prêtent, bascule dans une radicalisation meurtrière.
Ça commence à être un peu plus clair. Je continue…
Roger Griffin, historien britannique, proposait une clé simple : le fascisme, c’est avant tout un mythe de renaissance nationale. Une promesse d’arracher une nation en déclin pour la régénérer.
C’était le “Romain nouveau” de Mussolini, le “Reich de mille ans” de Hitler. C’est aujourd’hui le “Make America Great Again” de Trump, ou le “La France aux Français” du FN. Ce récit est si puissant qu’il dépasse les faits : il transforme des sociétés entières en quête d’un âge d’or imaginaire, prêt à tout pour y retourner. Un c’était mieux avant d’ailleurs souvent fantasmé, voire mythifié.
Il faut insister : le fascisme n’est pas une simple dictature.
Il n’est pas seulement une question d’autorité. Ce qui le distingue, c’est cette combinaison : un chef charismatique, une communauté exaltée, un ennemi désigné, un récit de régénération, et une érosion délibérée de l’État de droit au nom d’une unité supérieure.
Quand ces ingrédients, que je développe un peu plus tard, se mélangent, la démocratie se trouve aspirée dans un trou noir dont elle ne sort pas indemne, dont personne ne sort indemne.
Ces analyses se fondent sur l’étude du passé, sur une prise de recul essentielle. Pour comprendre ce qui se joue devant nous il faut souvent regarder en arrière, voir comment, en d’autres temps, des sociétés entières ont basculé presque sans s’en rendre compte. On a parlé rapidement des caractéristique du fascisme des années 1930, on va maintenant se souvenir des dynamiques qui lui ont permis de prendre le pouvoir. Petit coup d’oeil dans le rétroviseur
2. Le XXe siècle comme avertissement
Le XXe siècle reste le grand laboratoire des totalitarismes, on a expérimenté tout plein de trucs sympas, juste pour voir, de grands créatifs nos alleux. C’est là que nos peurs politiques actuelles ont pris forme, notamment dans le choc de deux guerres mondiales et de leurs suites.
On y a vu des sociétés entières basculer, parfois en quelques mois, dans des logiques qui semblaient impensables juste avant.
Quels sont les grands enseignements sur le jeu de dominos qui mènent à la catastrophe ?
Hannah Arendt, dans Les Origines du totalitarisme, écrivait que la première condition pour qu’un régime totalitaire s’impose, c’est la solitude. Pas seulement la solitude individuelle, mais cette atomisation sociale où les liens de confiance se dissolvent, où les individus se sentent déconnectés d’une communauté de sens.
Dans cette solitude, chacun devient vulnérable aux récits totalisants qui donnent une explication simple, pratique, absolue. C’est comme ça que les idéologies de masse, nazisme ou stalinisme, ont pu séduire : elles proposaient une réponse claire à des sociétés désorientées, un sens, un groupe.
Aujourd’hui, on utilise le mot “polarisation”. Des millions de personnes enfermées dans des bulles informationnelles, incapables de partager une réalité commune, des sociétés “archipelisées”, des communautés effondrées. Le terrain fertile est là : quand plus personne n’est d’accord sur les faits, tout récit qui promet une vérité simple peut s’imposer et quand on se sent seul, on cherche du lien.
George Mosse, historien spécialistes des mentalités, lui, parlait de la brutalisation.
Après la Première Guerre mondiale, les sociétés européennes avaient été habituées à la violence : millions de morts, tranchées, gaz, destructions. Le fascisme s’est engouffré dans ce climat, transformant la virilité guerrière en modèle politique, banalisant l’usage de la force comme langage naturel du pouvoir.
Un siècle plus tard, il n’y a pas eu de guerre totale en Occident depuis quelques temps, le souvenir s’évapore, mais une autre forme de brutalisation est à l’œuvre : celle des réseaux sociaux, des medias, de la culture populaire en générale (musique, films, jeux vidéos). Violence verbale, insultes permanentes, déshumanisation de l’adversaire, banalisation de l’agressivité, notamment parce que c’est vendeur. Comme si l’espace public, qui comprend désormais le virtuel, était devenu un champ de bataille, où l’on s’habitue à voir des menaces et des humiliations quotidiennes. Cette normalisation de la haine prépare, elle aussi, le terrain à des formes d’autoritarisme.
Karl Polanyi, dans La Grande Transformation, analysait autrement la montée des fascismes, avec ses lunettes d’économiste : il y voyait une réaction désespérée aux excès du marché autorégulé.
Quand les sociétés sont broyées par l’insécurité économique, par le chômage de masse, par la perte de protection sociale, elles cherchent une planche de salut. Le fascisme a offert cette protection, non pas par la démocratie, mais par l’autorité, en promettant de protéger la nation contre le chaos.
Aujourd’hui, les inégalités explosent, les protections sociales s’érodent, et beaucoup ressentent cette même insécurité. La tentation de l’autoritarisme revient : “au moins, avec lui, ce sera plus clair, plus simple, plus sûr.”
Enfin, Arno Mayer, un autre historien, oui j’ai bien bossé et j’ai appris plein de trucs… Mayer rappelait que ces régimes ne se sont pas installés seulement par séduction, mais aussi par la peur et la contre-violence.
La spirale est connue : une menace perçue (réelle ou exagérée), une répression brutale qui entraîne une radicalisation en retour, puis une escalade de terreur.
Dans l’Allemagne nazie, ce fut le spectre du bolchevisme et la haine des juifs ; en Italie, la peur du désordre social et aussi du communisme.
Aujourd’hui, c’est l’immigration et le grand remplacement, l’islamisme et ses kalach ou simplement l’islam et ses coutumes, le “woke” qui nous embrouille avec sa bien-pensance, sa censure et ses histoires de genre, le mexicain violeur et voleur, ou toute autre figure de l’ennemi intérieur, amplifiés jusqu’à devenir obsession nationale.
À cela s’ajoute une autre dimension, souvent oubliée : le rôle du grand capital. Comme l’avait notamment expliqué dès 1936 Daniel Guérin dans Fascisme et grand capital, Mussolini et Hitler n’ont pas conquis le pouvoir seuls, portés par la seule ferveur populaire. Ils ont bénéficié de l’appui décisif des magnats de l’industrie lourde, des banques et des grands propriétaires terriens. Face aux grèves, aux occupations d’usines, à la menace d’expropriation, ces élites économiques ont financé les milices, puis soutenu l’instauration d’un “État fort” capable d’écraser les syndicats et de rétablir l’ordre social. Le fascisme, loin d’être un corps étranger au capitalisme, fut aussi selon certains, un instrument de sa survie en temps de crise. A noter ici que d’autres penseurs ont théorisé que le fascisme peut être interprété comme une réaction à une crise du capitalisme, sachant que le capitalisme peut prendre tout plein de formes. Comme souvent, c’est subtil.
OK, on y voit un peu plus clair.
Mais ce que nous dit aussi le XXe siècle, ce n’est pas seulement “plus jamais ça”. C’est aussi : “ça peut revenir autrement”. Il suffit de solitude sociale, de brutalisation culturelle, d’insécurité économique et de peur de l’autre. Ajoutez un chef charismatique, des ennemis bien identifiés, des outils de connaissance de millions de cerveau couplés à des outils de propagande ultra sophistiques et bien-sûr un récit de régénération de la grandeur passée, secouez tout ça et le cocktail est prêt.
Ces logiques n’ont en fait jamais vraiment disparu. Elles resurgissent ailleurs, autrement. Plus dans les tranchées ou les usines en faillite, mais dans nos fils d’actualité, nos écrans, nos colères accumulées. Plus en brassards, mais en casquettes rouges ou en costards impeccables. Elles n’annoncent pas forcément une guerre mondiale, mais elles promettent toujours de “régénérer” une nation prétendument déchue.
Et il faut dire deux mot aussi sur la mécanique de l’habitude. Stefan Zweig racontait dans Le Monde d’hier que les peuples d’Europe ne croyaient jamais marcher vers leur propre ruine : ils pensaient toujours ne céder “qu’un peu”, s’accommoder “pour un temps”, jusqu’à ce qu’il soit trop tard.
Arendt l’avait vu aussi : le totalitarisme ne s’impose pas par un coup de tonnerre, mais par une lente banalisation, une succession de petits pas qui paraissent supportables. C’est ce qui rend ces logiques si redoutables : elles avancent masquées, par ajustements progressifs, jusqu’à ce que l’inacceptable devienne normal. Et c’est exactement cette stratégie que l’on retrouve aujourd’hui, sous d’autres formes, dans l’Amérique de Trump.
Allez, on revient au présent tout chaud tout beau.
3. Trump et la fabrique de l’autoritarisme
Trump n’est pas Mussolini. Trump n’est pas Hitler. Mais il incarne quelque chose d’autre : un leader qui, au XXIe siècle, utilise les failles d’une démocratie pour la remodeler à son avantage, non pas par un coup d’État spectaculaire, mais par un lent travail d’érosion. Pas besoin de marche sur Rome, pas besoin de Reichstag en flammes : il a un parti, un congrés, les écrans, une base électorale à sa botte et désormais quasiment les pleins pouvoirs.
Il ne s’agit pas de plaquer un schéma du passé, mais de voir comment un certain nombre de traits fascisants — identifiés par les historiens — trouvent aujourd’hui une expression nouvelle. Alors on va les lister et voir ce qu’il en est.
1. Le culte du chef
Le fascisme, ce n’est pas seulement un autoritarisme fort. C’est l’idée que le chef incarne le peuple, qu’il est la voix unique capable de dire ce que la nation veut. Trump l’a dit sans détour : “I am your voice. I alone can fix it.”
Ses rassemblements ne sont pas de simples meetings politiques, mais des rituels d’allégeance. On y rit, on y crie, on y chante. Les slogans remplacent les arguments, les insultes deviennent des punchlines. Là où Mussolini avait ses balcons et Hitler ses stades, Trump a ses shows télévisés, ses tweets et ses punchlines calibrées pour devenir virales.
Mais ce culte s’appuie aussi sur une marque, construite depuis des décennies. Trump Tower, Trump University, Trump steaks, Trump vodka, hôtels, casinos… jusqu’à une crypto-Trump ou la nouvelle Trump Gold card frappée de son visage pour l’étranger qui souhaite débourser un million de dollars pour obtenir un droit de résidence etats-unien. Tout est pensé pour que son nom et son image soient partout, comme un sceau d’autorité.
Cette logique s’est transposée en politique : casquettes MAGA, logos, gadgets, slogans. Ses partisans n’achètent pas seulement une idée, ils consomment une identité. Et derrière, Trump se met en scène comme un chef suprême, un homme providentiel qui gouvernerait seul, au-dessus des contre-pouvoirs.
“I am your warrior. I am your justice. I am your retribution.”
2. L’ennemi intérieur et la haine des élites
ennemy from within : https://www.youtube.com/watch?v=1vZM2HlRfSk
vermin, rapists : https://www.youtube.com/watch?v=QCtdF3HwVrI
journalists. https://www.youtube.com/shorts/OfSqSl-kKcchttps://www.youtube.com/watch?v=FRtFW4tPrz0https://www.youtube.com/watch?v=v3abZ4aAGUUhttps://www.youtube.com/watch?v=NTg_y_dQXlM
Un chef autoritaire ne se maintient pas sans adversaire. Trump excelle dans l’art de les fabriquer. Les journalistes deviennent des “traîtres au peuple”. Les juges sont décrits comme corrompus. Les opposants politiques comme des “vermines”, des “ennemis de l’intérieur”. Les migrants sont réduits à des criminels ou des violeurs.
C’est une mécanique classique : déshumaniser pour justifier. Mais Trump ajoute une torsion moderne : il retourne l’accusation. Ce seraient les démocrates, les progressistes, les journalistes qui seraient les “fascistes”, ceux qui menaceraient la liberté. Le langage n’a plus pour fonction de décrire, mais de frapper. Dire que l’autre est fasciste, c’est le réduire au silence, détourner l’attention, occuper le terrain. Le mot ne décrit plus une réalité : il fabrique une réalité.
Et cette rhétorique s’accompagne d’actions concrètes : limogeages de journalistes accrédités à la Maison Blanche, mise à l’index de chaînes jugées hostiles, pressions directes sur les rédactions. À cela s’ajoutent les procès contre ses opposants, les campagnes de diffamation, les harcèlements médiatiques orchestrés par ses relais. Tout va très vite : l’insulte ouvre la voie à la sanction, et la sanction installe une peur diffuse.
3. Nationalisme identitaire et peur du remplacement
Pour Trump, l’Amérique doit “redevenir grande” en retrouvant son peuple “authentique”. Pas seulement une entité politique, mais une communauté définie par la race, la religion et l’histoire.
Ce n’est pas un patriotisme inclusif, c’est une vision identitaire : seuls certains appartiennent vraiment à la nation, les autres sont des menaces, des corps étrangers. C’est la logique du remplacement : si l’on ne réagit pas, les “vrais Américains” seraient submergés par des migrants, des minorités, des “déloyaux”.
On retrouve ici un ressort central du fascisme : l’État n’est plus le garant de droits égaux, mais l’outil de protection et de purification d’une communauté supposée supérieure. https://www.youtube.com/watch?v=a6DygrX3ke4
4. La glorification de la force et de la violence
Le fascisme exalte la virilité guerrière et la brutalité comme moteur de l’histoire. Trump reprend cette logique :
“Our people are tougher and stronger and meaner and smarter.”
“I am your warrior. I am your justice. I am your retribution.” “I’d like to punch him in the face.”https://www.youtube.com/watch?v=1es9MZyyPOA
Cette rhétorique n’est pas qu’une posture. Elle s’est incarnée dans les faits, lors de l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Trump avait chauffé ses partisans : “If you don’t fight like hell, you’re not going to have a country anymore.” Le résultat : une foule déchaînée, des élus retranchés, une démocratie vacillant sous la pression de la violence. Depuis, loin de prendre ses distances, Trump a transformé ces émeutiers en martyrs patriotiques, promettant des grâces présidentielles à ceux qui ont attaqué les institutions.
Ses politiques vont dans le même sens. ICE, l’agence de l’immigration, agit comme une quasi-milice : rafles hors du cadre légal, centres de détention, menaces de déportation de millions de personnes. Trump vise aussi à purger l’armée de ses officiers jugés trop indépendants, pour la rendre “loyale”. Et son conseiller Stephen Miller reprend des slogans directement inspirés de la rhétorique fasciste, comme ce “We are the storm” entendu lors des funérailles de Kirk — une promesse de purification par la force.
Et je passe des extraits de son discours…
La violence n’est plus un accident : elle devient une méthode, une bannière, une promesse.
5. Le mépris des plus fragiles
Le fascisme historique reposait sur une vision patriarcale et hiérarchique : les forts dominent, les faibles obéissent. Trump reprend ce schéma, en l’élargissant. Sa rhétorique comme ses politiques valorisent la force et la réussite économique au détriment de toute protection des plus vulnérables. Pas de pitié pour tous qui rentrent pour lui dans la case “loser”. Restrictions du droit à l’avortement, attaques contre les droits LGBTQ+, suppression de programmes sociaux : tout ce qui protège les femmes, les minorités ou les plus faibles est présenté comme un obstacle à la “grandeur” américaine.
C’est un darwinisme social assumé : une société où la valeur d’un individu se mesure à sa loyauté et à sa capacité de gagner, pas à ses droits fondamentaux.
6. La post-vérité et les algorithmes
Le mensonge n’est pas une erreur, c’est une stratégie. Saturer l’espace public de contradictions, jusqu’à rendre la vérité indiscernable. Ce qui compte n’est plus la cohérence, mais la loyauté. Croire Trump non pas parce qu’il dit vrai, mais parce qu’il est Trump. Ses partisans n’adhèrent pas à chaque phrase, mais au récit global : un monde corrompu où seul lui peut apporter la lumière.
Comme l’écrivait Arendt, le totalitarisme commence par la destruction d’une réalité partagée. Aujourd’hui, ce rôle est assuré par les algorithmes : chacun enfermé dans sa bulle d’informations sur mesure où la vérité devient relative, où l’émotion prime sur le fait. La propagande fasciste passait par des radios et des journaux ; Trump a X et Truth Social. Une seule punchline virale suffit à atteindre des millions de personnes. La haine y devient rentable, amplifiée parce qu’elle génère du clic.
7. La capture de l’État
Derrière l’improvisation apparente, il y a une méthode. Project 2025, conçu par la Heritage Foundation, n’est pas un manifeste flamboyant mais un manuel administratif. Il prévoit de purger des milliers de fonctionnaires, de réorienter des financements publics vers des programmes religieux conservateurs, de renforcer l’appareil répressif migratoire et de rogner l’indépendance des agences. Et le projet est mis en place à une vitesse folle. “Project 2025 Tracker” un site qui suit en détail l’avancement évoquait environ 47 % d’objectifs déjà atteints ou sur le point de l’être.project2025.observer
Les institutions ne disparaissent pas, elles sont retournées. Le Département de la Justice devient une arme contre les opposants. La FCC menace les médias critiques. La Cour suprême, acquise au camp conservateur, valide les décisions les plus contestées. Tout semble “dans les règles”, mais c’est une mise en scène : la démocratie conserve ses formes, mais perd son sens.
8. La diplomatie comme prolongement du spectacle
Trump ne se contente pas d’isoler les États-Unis, il menace. Sanctions économiques arbitraires, humiliations publiques de dirigeants alliés, refus d’aide humanitaire, remise en cause de la souveraineté d’autres États : la diplomatie devient un prolongement de son spectacle intérieur. Il ne cherche pas à construire un ordre, mais à imposer une force brute.
À la tribune de l’ONU, le 23 septembre 2025, il moque l’institution qui l’acceuil, dénigre la science en qualifiant le réchauffement climatique de « plus grande escroquerie de l’histoire », fustige les politiques vertes, exhorte les pays à fermer leurs frontières.
Quelques extraits : ****https://www.youtube.com/shorts/1NpzcZznx7Ihttps://www.youtube.com/shorts/Zz7V_L7HM08
Il est temps d’arrêter l’experience des frontières ouvertes. Vos pays sont en train de descendre en enfer Vous detruisez vos pays, l’europe a de serieux problèmes, ils ont été envahis par une force de migrants illégaux, ce n’est pas soutenable, et comme ils préfèrent être politiquement correct, ils ne font strictement rien à ce propos Le maire de Londres est horrible, ils veulent appliquer la charia.
Et personne dans la salle ne réagit.
9. Le grand capital comme allié
Dans ce théâtre, l’argent joue un rôle central. Le fascisme des années 30 a prospéré en s’adossant au grand capital ; Trump, lui, est à la fois l’allié et le visage de ce capitalisme débridé. Obsédé par l’argent, milliardaire se définissant comme businessman et “gagnant”, il confond pouvoir et richesse. Il veut montrer qu’il est riche, qu’il attire les riches, qu’il incarne la réussite.
Là où Mussolini comptait sur Fiat et Hitler sur Krupp, Trump s’appuie sur une nouvelle oligarchie : celle du numérique et de la finance. Elon Musk, lui a offert une caisse de résonance mondiale et l’a financé et les GAFAM lui prêtent allégeance. https://www.youtube.com/watch?v=dsl_sKYywEI
Le trumpisme est indissociable d’un hypercapitalisme débridé, où les intérêts privés et l’autorité politique fusionnent. Et Trump et sa famille s’enrichissent comme jamais grâce aux conflits d’intérets criants.
Pris séparément, ces éléments pourraient sembler disparates. Mais mis ensemble, ils dessinent une logique cohérente.
Le culte du chef.
L’ennemi intérieur.
Le mythe national.
La force brute.
Le patriarcat.
La négation du réel
La capture de l’État.
La diplomatie-spectacle. La collusion avec les forces de l’argent
C’est bien le visage d’un fascisme adapté à l’ère des algorithmes et des milliardaires. Pas une copie conforme des années 30, mais une mutation. Un autoritarisme hypercapitaliste, religieux et technologique.
Et le plus inquiétant à observer, c’est que rien de tout ça n’est caché : tout est annoncé, assumé, répété, commenté depuis 10 ans maintenant.
Mais quittons le spectacle américain et parlons maintenant d’Europe
4 . Les extrêmes droites européennes : cousins ou voisins ?
Le trumpisme n’est pas une exception américaine. C’est un laboratoire, et ses répliques se font sentir de ce côté ci de l’atlantique, presque en temps réel. Alors les USA ne sont pas l’Europe et il faut éviter les raccourcis, mais des slogans traversent l’océan, les financements circulent discrètement, les récits se copient, parfois mot pour mot. Et la droite américaine, l’Alt-right, a une stratégie d’influence qui dépasse les frontières.
Revenons à ce rassemblement de Londres évoqué en introduction, le 13 septembre. Plus de cent mille personnes derrière Tommy Robinson, figure de l’ultra-droite britannique. Chose rare en Angleterre, la manifestation dégénère, la police est débordée. Et sur écran géant, en Californie, apparaît Elon Musk, qui lance à la foule des punchlines visant à apaiser les foules: ”The left is the party of murder, and celebrating murder” https://www.youtube.com/watch?v=If9etIMpk_A ““violence is gonna come to you . You either fight back or you die. that’s the truth” Des mots, brutaux, qui claquent comme une déclaration de guerre culturelle.
L’image dit tout : un oligarque de la tech américain parlant à une foule britannique, comme si les frontières politiques s’étaient dissoutes.
Le UK est un front évident de la bataille qui se joue à grande échelle, mais ailleurs en Europe, les choses sont déjà bien avancées.
Viktor Orbán, en Hongrie, a fait de son pays un laboratoire illibéral. Depuis 2010, il a muselé la presse, placé la justice sous tutelle, réécrit la Constitution pour verrouiller son pouvoir, et transformé les universités en outils idéologiques.
Giorgia Meloni, en Italie, ne fait certes pas du fascisme, gardons le sens de la mesure, mais assume comme triptyque central “Dieu, patrie, famille”, et a déjà restreint certains droits des couples homosexuels tout en menant une politique migratoire très dure. On veut de l’ordre !
En Allemagne, l’AfD, franchit un cap : ses leaders parlent de “relocaliser” des millions de migrants, certains évoquent le retour de “communautés ethniques homogènes” et on scande “tout pour l’allemagne”, autrement dit le mot d’ordre des SA, la milice paramilitaire des Nazi. Ce qui leur vaut d’ailleurs un procès.
Ici et là, le même mouvement de fond : l’extrême droite quitte la marge, se normalise, s’installe au centre du jeu.
Les différences restent fortes, certes, les institutions ne sont pas les mêmes partout : Orbán gouverne d’une main de fer, Meloni compose avec les équilibres italiens, l’AfD reste dans l’opposition et le RN premier partie de France reste aux portes du pouvoir.
Mais derrière ces singularités, un air de famille se dessine. Le récit du déclin national. L’obsession migratoire. La dénonciation du “woke” comme menace civilisationnelle.
Et de plus en plus souvent, une inspiration assumée venue des États-Unis.
Ce n’est pas seulement une convergence idéologique cette circulation est voulue, organisée activement même.
Des think tanks américains financent des campagnes en Europe. Des stratèges de communication partagent leurs méthodes. Les slogans passent les frontières : “Make Europe Great Again”, “grand remplacement”, “fight back or die”. Trump s’en prend régulièrement à l’Europe en nous expliquant que vraiment nous n’avons rien compris.
Côté russe, les soutiens sont discrets mais constants : prêts accordés, relais médiatiques, campagnes de désinformation.
C’est une Internationale illibérale, souterraine mais efficace, où se croisent oligarques de la tech, magnats du pétrole, stratèges politiques et leaders d’extrême droite.
Mais soyons clairs, si ce récit prospère, c’est aussi qu’il rencontre un terrain fertile.
La perte de repères culturels nourrit le sentiment de déracinement : pour certains, c’est la foi chrétienne qu’on croit menacée, pour d’autres, la laïcité ou simplement un mode de vie “traditionnel”.
Le déclassement économique ajoute une couche : précarité croissante, inégalités qui explosent, jeunesse qui doute d’avoir un avenir meilleur que ses parents. Et le racisme latent qui resurgit dès qu’on gratte un peu. Le sentiment de déclin général, lui, est partout : une Europe vieillissante, bousculée par les puissances émergentes, incapable de se projeter.
Et puis il y a la question brûlante du communautarisme. Les violences djihadistes ont laissé des traces profondes. Elles nourrissent le récit de l’incompatibilité culturelle, qu’il soit exprimé au nom de la laïcité, de l’identité chrétienne ou simplement d’un “mode de vie menacé”.
Et il faut le dire : une frange radicale de l’islam fonctionne elle aussi sur une logique totalitaire, avec son langage d’ennemis absolus et de pureté identitaire. Chaque attentat, et même chaque fait divers, devient ainsi une pièce de plus dans l’argumentaire de l’extrême droite.
Tout cela rappelle les années 30 : insécurité économique, peur de l’autre, sentiment de décadence, violence culturelle. Mais avec des leviers différents. À l’époque, c’étaient les tranchées et la crise de 1929. Aujourd’hui, ce sont les flux migratoires, les attentats, les algorithmes et les fractures identitaires donc. Et comme à l’époque, le laisser faire. La Hongrie toujours dans l’UE comme si de rien, on a négocié jusqu’au bout avec Poutine en espérant le calme, et on se couche devant Trump.
Petit aparthé : on peut noter que ces attaques contre l’État de droit ne sont pas réservées aux extrêmes et j’ai déjà abordé le sujet dans un autre épisode. Elles apparaissent aussi au centre, au nom de l’efficacité, de la sécurité ou simplement au détour de la critique d’une décision de justice. Et une certains gauche avec ses errements sur la russie, le hamas et certains comportements n’est pas en reste. On se reclame de la république mais on critique une décision de justice lorsqu’elle ne nous convient pas…
https://www.youtube.com/watch?v=0dly3-jWoDs
La tentation autoritaire dépasse les étiquettes politiques. Chaque mouvement a son ancrage national, mais ils se regardent, s’inspirent, se renforcent. Et à mesure que le centre se fragilise, que les crises s’aggravent, leur terrain de jeu s’élargit.
5. Nommer le fascisme aujourd’hui : piège ou nécessité ?
Alors comment qualifier tout ça.
Le mot revient partout.
Trump qualifié de fasciste. Meloni aussi. L’AfD aussi. Parfois même Macron, pour ses détracteurs, ou les militants de gauche, les woke, les écolos jugés “autoritaires” par la droite. On parle de “dictature verte” avec banalité. Le mot se dilue à force d’être employé.
Et c’est bien là le problème : faut-il parler de fascisme pour nommer ce qui monte aujourd’hui, ou est-ce une erreur qui finit par brouiller la compréhension ?
D’un côté, il y a ceux qui refusent le terme. “Trump n’est pas Hitler”, “Meloni n’est pas Mussolini”. Pas de parti unique, pas de pogrom, pas d’autodafé, pas de projet impérial mondial. À trop crier au fascisme, on finit par affaiblir l’alerte. Comme le dit l’historien Enzo Traverso, chaque époque invente ses propres formes d’autoritarisme, et il faut parfois inventer des mots nouveaux pour les comprendre.
Mais de l’autre, il y a un risque symétrique : si on refuse trop vite le terme “fascisme”, on passe à côté des logiques profondes.
Umberto Eco, rappelait qu’il ne s’agit pas d’un “paquet fermé”, mais d’une constellation de traits : culte du chef, obsession de l’ennemi, culte de la jeunesse, refus de la complexité, peur de la différence, manipulation du langage… on commence à avoir une idée du contour de la chose. Tous ne sont pas toujours présents, mais leur combinaison peut produire une atmosphère familière. Sous cet angle, le trumpisme et les droites radicales européennes cochent déjà de nombreuses cases.
Mais ce qui complique encore les choses, c’est que le mot est devenu une arme rhétorique en soi. Trump et Poutine traitent leurs adversaires de “fascistes”, Orbán dénonce l’Union européenne comme “totalitaire”, l’extrême droite parle d’“antifa fascistes”. Le langage se retourne sur lui-même, les mots se vident de sens.
Comme l’explique Timothy Snyder, c’est typiquement fasciste : le langage n’est plus là pour décrire, mais pour dominer.
À ce brouillage s’ajoute une autre forme de relativisation : la comparaison classique avec le communisme. “Et Staline ? Et Pol Pot ? N’ont-ils pas fait pire ?”
Cette rhétorique vise à neutraliser l’alerte en renvoyant dos à dos des systèmes différents. Or, si fascisme et communisme partagent certains traits – culte du chef, terreur d’État, surveillance de masse –, ils reposent sur des mythes distincts : national et guerrier pour le fascisme, égalitaire et utopique pour le communisme. Les deux ont abouti à la négation de la dignité humaine, mais par des chemins différents. Répéter cette comparaison, c’est brouiller les repères et détourner le regard du danger qui se dessine ici et maintenant.
Alors, faut-il continuer à utiliser ce mot ? Oui, mais avec discernement. Pas comme une insulte automatique, mais comme une boussole historique. Nommer le fascisme aujourd’hui, c’est rappeler les logiques qui l’ont nourri, et observer comment elles se recomposent dans le présent. Il ne s’agit pas de chercher une copie conforme de 1933, mais de voir les dynamiques, et ce vers quoi elles conduisent les peuples lorsqu’elles s’installent.
Il y a aussi une fonction civique dans ce choix des mots. Arendt disait que les mots sont comme des fenêtres : ils nous permettent de voir ce qui est en train d’arriver. Si l’on renonce trop tôt au mot fascisme, on risque de fermer cette fenêtre et de ne pas reconnaître le danger pour ce qu’il est. Mais si on l’utilise à tort et à travers, on finit par transformer l’alerte en bruit de fond, en contribuant au brouillage.
L’histoire nous éclaire, mais elle ne suffit pas. Reconnaître le fascisme, c’est accepter qu’il ne soit pas un cadavre du passé, mais une tentation permanente des sociétés en crise.
Halford E. Luccock avait déclaré en 1938 : " Si et quand le fascisme viendra en Amérique il ne sera pas accompagné d'une mention « fabriqué en Allemagne » ; il ne sera pas marqué d'une swastika
6. Que faire de cette confusion ?
Super, Julien. C’est bien joli tout ça. On peut utiliser le mot fascisme, mais pas trop. On peut comparer, mais sans exagérer. Très bien. Mais alors, qu’est-ce qu’on fait ?
Je dis : Trump est un fasciste. Et alors ?
Que fait-on de cette montée de l’autoritarisme dans un monde saturé d’images et de propagande, avec des écrans branchés H24 sur nos colères et nos peurs ?
Que fait-on de la post-vérité, des milliardaires sans patrie qui tiennent entre leurs mains nos moyens de communication, de déplacement, d’information ?
Que fait-on de tout ça alors même que la maison brûle, que l’urgence écologique est là, implacable ?
D’abord admettre que c’est une constante : les autoritarismes exercent une séduction.
Ils offrent des récits clairs, un ennemi à désigner, une communauté à retrouver.
Dans un monde marqué par la crise de sens, par la peur de l’avenir, par l’appauvrissement et par le doute sur ce qui nous unit encore, ces récits agissent comme des antidépresseurs politiques.
Le fascisme prospère parce qu’il est tentant. C’est tentant de suivre quelqu’un qui prétend avoir les solutions. Tentant de faire partie d’un “nous” qui se croit pur, face à un “eux” diabolisé. Tentant d’oublier la complexité pour retrouver une simplicité brutale. Ça fait tellement de bien de poser son cerveau, de se laisser guider dans ce monde incertain, souvent angoissant. Tout ira bien, laissez nous faire, ayez confiance, vous ne craignez rien vous, ce sont les autres les responsables.
Et nous assistons à tout cela en direct. Nous regardons la montée de l’autoritarisme et en même temps son déni.
Pendant des décennies, on s’est demandé : comment a-t-on pu laisser faire ? comment des sociétés entières ont-elles pu basculer dans la haine, le génocide, la perte de raison ?
Aujourd’hui, nous comprenons. Nous voyons la complaisance des puissants, y compris à l’ONU.
Nous voyons le spectacle qui éblouit les foules, qui transforme la politique en un show permanent.
Car le fascisme fut toujours d’abord un spectacle : parades militaires, foules en transe, slogans scandés en boucle.
Walter Benjamin parlait de “l’esthétisation de la politique” : le pouvoir transformé en mise en scène, destiné à éblouir plus qu’à convaincre.
Aujourd’hui, ce spectacle est sous stéroïdes. Il ne se joue plus seulement sur les places publiques mais sur nos écrans, toujours là.
Et nous, spectateurs, nous croyons être à distance. Nous nous disons que ce n’est qu’un flux, une distraction.
Mais c’est précisément cette passivité qui fait le jeu du fascisme moderne.
Le spectacle nous anesthésie, nous retire l’envie d’agir, nous transforme en public passif et satisfait.
Et nous sommes tous vulnérables. Nos esprits ont des failles bien connues. Nous cherchons d’abord ce qui confirme nos peurs : c’est le biais de confirmation. Nous nous croyons toujours un peu à l’abri, persuadés que le danger frappera ailleurs : c’est le biais d’optimisme. Nous préférons la chaleur rassurante du groupe au doute inconfortable : c’est le biais d’appartenance. Et, peu à peu, à force de répétition, nous nous habituons : ce qui hier semblait inacceptable finit par paraître normal, le principe d’habituation
C’est humain.
Hannah Arendt rappelait que c’est justement dans ces moments de peur et de désorientation que les démocraties sont les plus vulnérables.
Parce que nous avons tendance à nous replier, à espérer que “ça passera”, ou à croire que seuls les autres seront touchés. Comme dans 1984, quand Winston observe ses compagnons de cellule et comprend que chacun pensait : “Cela n’arrivera pas à moi.”
Cette mécanique psychologique est universelle : nous croyons toujours que nous serons épargnés. C’est précisément ce qui rend la vigilance si difficile, et l’autoritarisme si efficace.
Peut-être que demain, le danger autoritaire sera d’une autre nature.D’extrême gauche, sous la promesse d’égalité absolue.Religieux, sous la bannière d’un Dieu unique. Ou technocratique, au nom de l’efficacité.
L’Histoire ne se répète pas, elle invente toujours de nouvelles formes. Et personnellement je ne fais pas partie de ceux qui minimisent les risques de dérive autoritaire de toute forme d’idéalisme, idéalisme libéral, égalitaire, religieux donc.
Et oui, ce qu’on appelle la morale bien-pensante peut aboutir à de la censure ou de la discrimination. Oui, l’hindouisme, l’islam, le judaïsme ou le christianisme peuvent justifier des régimes autoritaires, voire des massacres. Toute idéologie qui se croit supérieure et se ferme.
Mais aujourd’hui, ici, il me semble que le risque imminent est bien celui d’un autoritarisme de droite, qui s’installe déjà au pouvoir dans de nombreux pays et frappe à la porte ailleurs, en promettant de répondre à nos peurs, comme hier, et avec potentiellement les conséquences que l’histoire nous enseigne.
Et c’est précisément parce que cette promesse est séduisante, parce qu’elle a déjà séduit, qu’elle est dangereuse.
Faut-il pour autant baisser les bras ?
Non évidemment.
La résistance existe, même dans les interstices. Une preuve récente : sous la pression citoyenne, Jimmy Kimmel Live! a retrouvé l’antenne, malgré la suspension imposée. Un petit épisode, mais qui montre que la résistance peut payer, que les contre-pouvoirs, même fragiles, tiennent encore.Les États-Unis n’ont pas encore complètement basculé. Certains ne se laissent pas faire.
L’histoire, justement, nous montre que le fascisme n’est pas une fatalité. Il prospère quand les élites pactisent, quand la société se tait, quand les contre-pouvoirs s’effondrent.
Mais qu’il peut être freiné quand des institutions, des citoyens, des voix refusent de céder. Il faudrait aller dire ça à tous ces grands patrons de la Tech américaines qui se taisent et font des courbettes, à tous ces puissants qui auraient les moyens de lutter et qui se couchent pas peur d’y perdre quelques millions et quelques plumes, tous ces hommes prétendument forts, indépendants et qui baissent la tête. Lequel aura l’étoffe d’un Churchill ou d’un De Gaulle ?
Conclusion : résister sans certitude
J’attaque la conclusion de ma dissertation et vous remercie d’être arrivé jusqu’ici. Votre capacité d’attention est largement supérieure à la moyenne, bravo.
Résister, ce n’est pas croire qu’on peut stopper la vague d’un seul geste.
C’est garder une hygiène intellectuelle : refuser le brouillage des mots, défendre la nuance quand tout pousse à la caricature.
C’est retisser des liens, recréer une réalité commune face à l’atomisation sociale. C’est avoir ce courage banal, quotidien, de dire non, de protéger celui qu’on stigmatise, de défendre la complexité face aux slogans.
Timothy Snyder, dans On Tyranny, propose quelques leçons pour résister à l’autoritarisme. Pas des recettes miracles, mais des réflexes de survie démocratique. Ne pas obéir d’avance. Protéger les institutions. Sortir du rang. Défendre le langage. Préserver la vérité. Multiplier les liens humains. Soutenir des causes justes. Être courageux. etc… Il y en a 20 je vous en épargne quelques-uns. Autant de petits gestes qui, mis bout à bout, dessinent une résistance.
Bien sûr, je sais que je ne convaincrai pas ceux déjà happés par les récits autoritaires, séduits par la promesse d’ordre ou submergés par l’inquiétude du grand remplacement. Les outils de propagande sont trop puissants, les peurs ou même les blessures trop profondes, les mémoires trop courtes.
Mais j’estime que c’est mon devoir d’en parler.
La vraie question n’est pas : est-ce du fascisme ou pas ? La vraie question est : sommes-nous capables d’y résister, sous ses nouvelles formes ?
Et la réponse dépend de nous.
Elle ne viendra pas d’un chef, ni d’un parti, ni même d’une vérité unique. Elle viendra de notre capacité à penser ensemble, à nous relier, à résister à la facilité du spectacle.
Mais elle dépend aussi de la capacité des responsables politiques en place à mieux gouverner. Car le fascisme se nourrit de fantasmes, mais aussi du réel : chômage, précarité, insécurité, sentiment d’abandon.
Si ces problèmes sont ignorés ou traités avec condescendance, le terrain est laissé libre aux démagogues. Les partis au pouvoir portent une responsabilité immense : défendre l’État de droit, oui, mais aussi répondre aux inquiétudes légitimes, affronter les dégradations réelles de nos sociétés, au lieu de simplement dénoncer les colères.
Je veux croire, malgré tout que les digues construites pour éviter l’autoritarisme ne céderont pas, je veux croire, qu’avec internet et une information toujours accessible, le pensée unique ne primera pas.
Enfin, je veux croire qu’en Europe surtout, du fait de notre histoire et de notre éducation, nous sommes un peu plus immunisés contre le retour des fascismes. Mais c’était il y a bientôt cent ans, et tout cela reste fragile.
Alors je vous laisse avec cette réflexion :
Rester libres commence souvent par résister à la tentation de se croire du bon côté.
À méditer.
Je suis Julien Devaureix. Ceci n’est qu’une opinion, fondée sur des lectures et observations forcément partielles. Je ne prétends pas détenir la vérité et si ça se trouve Trump sera vraiment le sauveur de son pays. Et qui sait, peut-être le fascisme a-t-il échoué parce qu’on ne lui a pas donné assez de temps finalement, n’est-ce pas ? Je m’égare. Blague à part, faites vous votre propre opinion informée sur tout ça, il y a de quoi s’informer correctement et facilement quand on cherche un peu.
Tout ça représente beaucoup d’heure de travail, si vous appréciez, partagez les épisodes, parlez-en et si vous le pouvez faites un don pour me soutenir, même quelques euros, ça compte. Pas simple aujourd’hui d’être indépendant. Votre générosité c’est mon gagne pain. Merci à celles et ceux qui me soutiennent.
Et je vous laisse avec un peu de légèreté
Soutenez Sismique
Sismique existe grâce à ses donateurs.Aidez-moi à poursuivre cette enquête en toute indépendance.
Merci pour votre générosité ❤️
Nouveaux podcasts
Fierté Française. Au-delà du mythe d’un pays fragmenté
Comprendre le malaise démocratique français. Attachement, blessures et capacité d’agir
Les cycles du pouvoir
Comprendre la fatigue démocratique actuelle et ce vers quoi elle tend.
"L'ancien ordre ne reviendra pas"... Analyse du discours de Mark Carney à Davos
Diffusion et analyse d'un discours important du premier ministre du Canada
Écologie, justice sociale et classes populaires
Corps, territoires et violence invisible. Une autre discours sur l’écologie.
Opération Venezuela : le retour des empires
Opération Absolute Resolve, Trump et la fin de l’ordre libéral. Comprendre la nouvelle grammaire de la puissance à la suite de l'opération "Résolution absolue".
Vivant : l’étendue de notre ignorance et la magie des nouvelles découvertes
ADN environnemental : quand l'invisible laisse des traces et nous révèle un monde inconnu.
Les grands patrons et l'extrême droite. Enquête
Après la diabolisation : Patronat, médias, RN, cartographie d’une porosité
Géoconscience et poésie littorale
Dialogue entre science, imagination et art autour du pouvoir sensible des cartes