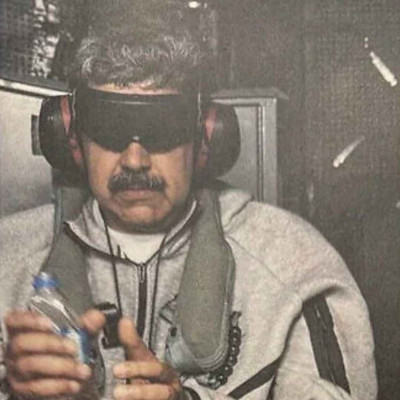Les démocraties libérales traversent une zone de turbulence profonde. Partout, le même doute s’installe : nos systèmes politiques sont-ils encore capables de décider, de protéger, de tenir face à un monde plus instable, plus conflictuel, plus contraint ?
Entre crises géopolitiques, tensions sociales, dérèglement climatique, fragmentation informationnelle et déplacement du pouvoir vers la finance et la technologie, les conditions qui ont permis à la démocratie de fonctionner au XXᵉ siècle se transforment rapidement. Dans ce contexte, la tentation de solutions plus autoritaires progresse, souvent au nom de l’efficacité, de l’ordre ou du « bon sens ».
Cet épisode propose de prendre du recul. De regarder comment les régimes politiques se transforment dans l’histoire, pourquoi certains s’épuisent, pourquoi d’autres durcissent, et ce que ces cycles disent du moment que nous vivons. Il ne s’agit pas de défendre un modèle par réflexe, ni de céder à la nostalgie, mais de comprendre les forces à l’œuvre, les impasses actuelles, et les risques des réponses trop simples.
Un épisode pour penser la crise démocratique autrement, à l’échelle historique et systémique, et interroger ce que gouverner veut dire dans un monde qui change plus vite que ses institutions.
1. À quoi sert un régime politique, concrètement
Un régime ne supprime pas les conflits, il organise des arbitrages entre ordre, liberté, égalité, sécurité et puissance.
Il tient tant que ces arbitrages restent compréhensibles et supportables, pour la société comme pour les élites.
La stabilité politique est toujours provisoire, jamais acquise.
2. Les cycles du pouvoir comme grille de lecture
Les régimes politiques s’usent moins par accident que par désalignement entre institutions, rapports de force et croyances.
Chez Polybe, chaque forme de pouvoir porte les germes de sa propre dégradation.
Ibn Khaldoun montre que les régimes déclinent quand l’énergie collective et la cohésion s’épuisent.
3. Le rôle central des élites dans les bascules politiques
Les transitions de régime sont rarement initiées par les peuples seuls, elles passent d’abord par les élites.
Vilfredo Pareto souligne que le pouvoir vacille quand les élites cessent de se renouveler et de se contenir.
Quand perdre devient existentiel, le compromis cesse d’être rationnel.
4. La démocratie libérale comme compromis historique
La démocratie libérale n’est pas un idéal moral pur, mais un système de méfiance organisée et de correction des erreurs.
Sa lenteur est fonctionnelle, elle permet l’alternance, la contestation et la réversibilité des choix.
Elle a prospéré dans un contexte matériel favorable, aujourd’hui profondément remis en cause.
5. Pourquoi ce compromis se grippe aujourd’hui
Fragmentation de l’espace informationnel, disparition d’un socle minimal de réalité partagée.
Fin de l’abondance énergétique et matérielle, qui rend les arbitrages plus visibles et plus douloureux.
Déplacement du pouvoir réel hors des arènes démocratiques classiques.
6. Démocratie et capitalisme, une tension structurelle
Une partie des élites économiques s’accommode mal d’une démocratie réellement redistributive.
Quinn Slobodian montre comment le capitalisme s’est protégé du risque démocratique depuis les années 1980.
La critique de la démocratie devient aujourd’hui plus explicite, incarnée par des figures comme Peter Thiel.
7. Pourquoi l’argument autoritaire séduit
Les régimes autoritaires décident plus vite, donnent une direction lisible, produisent de l’ordre visible.
Cette efficacité repose sur la compression du désaccord et l’affaiblissement des contre-pouvoirs.
L’autoritarisme fonctionne surtout tant qu’il n’a pas besoin de se corriger.
8. Comment une démocratie bascule en pratique
Les bascules sont progressives, légales, souvent présentées comme raisonnables ou nécessaires.
On commence par affaiblir l’information, la justice, les contre-pouvoirs, pas par supprimer le vote.
L’habituation rend ces glissements acceptables jusqu’à ce que l’alternance devienne impraticable.
9. Le malaise contemporain face aux élites
Les scandales, l’impunité perçue et la médiocrité visible alimentent un rejet profond des élites.
Ce rejet est souvent instrumentalisé par d’autres élites cherchant le pouvoir sans garde-fous.
La critique des élites peut devenir un levier autoritaire plutôt qu’un moteur démocratique.
10. Une question ouverte plutôt qu’une solution
La question centrale n’est pas « plus ou moins de démocratie », mais sa capacité à décider et à se corriger.
Les cycles historiques suggèrent que tout n’est pas maîtrisable, mais que les trajectoires ne sont pas neutres.
L’enjeu est d’atterrir politiquement sans rendre toute correction future impossible.
Concepts et notions
Anacyclose : théorie antique des cycles politiques selon laquelle les régimes se succèdent par usure interne plutôt que par rupture brutale.
Démocratie libérale : régime fondé sur la séparation des pouvoirs, l’État de droit et la réversibilité des décisions politiques.
Autoritarisme : forme de pouvoir concentré privilégiant la rapidité d’action et l’ordre, au prix de la compression du désaccord et des contre-pouvoirs.
Post-démocratie : situation où les formes démocratiques subsistent, mais où le pouvoir effectif s’est déplacé hors du contrôle citoyen.
Utilitarisme : conception de la justice visant à maximiser le bien-être du plus grand nombre, même si certains en paient le coût.
État de droit : principe selon lequel le pouvoir politique est limité par des règles juridiques supérieures, applicables à tous, gouvernants compris.
Penseurs et figures citées
Polybe : historien grec de l’Antiquité ayant théorisé les cycles de transformation des régimes politiques.
Ibn Khaldoun : penseur du XIVᵉ siècle analysant la montée et le déclin des pouvoirs à partir de la cohésion sociale et politique.
Vilfredo Pareto : sociologue et économiste italien ayant montré que le pouvoir repose toujours sur des élites, dont la circulation conditionne la stabilité des régimes.
Quinn Slobodian : historien contemporain analysant la mise à distance progressive de la démocratie par le capitalisme globalisé.
Peter Thiel : entrepreneur et investisseur technologique critiquant ouvertement la compatibilité entre démocratie et liberté économique.
Charles de Gaulle : figure historique évoquée comme exception dans l’usage temporaire de pouvoirs exceptionnels sans bascule autoritaire durable.
Contextes historiques
Fin de la République romaine : moment où les institutions subsistent formellement mais deviennent incapables de gouverner un empire élargi.
Début du XXᵉ siècle : période marquée par un décalage croissant entre pouvoir politique et pouvoir économique, préparant des réponses autoritaires.
Tournant des années 1980 : montée de la financiarisation et des mécanismes visant à limiter le contrôle démocratique sur l’économie.
Éléments d’actualité évoqués
Recul démocratique mondial : tendance observée depuis deux décennies, avec plus de pays sortant des standards démocratiques qu’y entrant.
Scandales impliquant des élites : révélations alimentant un sentiment d’impunité et de défiance envers les gouvernants.
Modèles autoritaires contemporains : Chine, Singapour, Salvador, souvent cités pour leur efficacité décisionnelle.
Contraintes structurelles actuelles : crises énergétique et climatique, fragmentation informationnelle, tensions géopolitiques accrues.
Études citées
Extraits audio :
Thomas Huchon - réseaux sociaux et democratie https://www.youtube.com/shorts/DMQqQGSGIJc
Mr Robot, les 0,1% https://www.youtube.com/watch?v=tJaLHsPDuQ4&t
Mr Robot, l’illusion du choix https://www.youtube.com/watch?v=Z39sU0WN79Y
Définition démocratie, Aladin https://www.youtube.com/watch?v=iQlLcWje8hQ
House of Cards - homme d’action https://www.youtube.com/watch?v=wQm68xjZj8Y
Bon sens https://www.youtube.com/watch?v=BF3wYJBc4eg
Yes we can Obama https://www.youtube.com/watch?v=Fe751kMBwms&t=355s
Cloud Atlas https://www.youtube.com/watch?v=r9EWmVaS8Qw
De Gaulle dictateur ? https://www.youtube.com/shorts/bvk5oDxU0hA
E.Macron fin de l’abondance https://www.youtube.com/watch?v=fOAc2RmeAHU&t=10s
Zemmour et les prénoms https://www.youtube.com/watch?v=QVMhDOVk7vI
Le bon sens https://www.youtube.com/watch?v=BF3wYJBc4eg&t
Nicolas Sarkozy, l’état de droit https://www.youtube.com/watch?v=6PXWjZ0Sack&t=29s
Dominique Reynié sur Tump comme symptome https://www.youtube.com/watch?v=z1w7WGWPpOo&t=59s
OSS117 - De Gaulle dictature https://www.youtube.com/watch?v=s6ylqpyik9M
Bonus The Dictator https://www.youtube.com/watch?v=mGLSanvh6ss
Penser les cycles, la crise et l’usure des régimes
Oswald Spengler – Le Déclin de l’Occident
Une lecture controversée mais structurante sur les cycles de civilisation, la fatigue des formes politiques et le passage de la culture à la gestion.
https://www.babelio.com/livres/Spengler-Le-Declin-de-lOccident/19520
Arnold Toynbee – A Study of History
Analyse comparative des civilisations, centrée sur leur capacité à répondre aux défis plutôt qu’à préserver des formes figées.
https://www.babelio.com/livres/Toynbee-A-Study-of-History/255381
Autorité, décision, exception
Carl Schmitt – La notion de politique
Texte clé pour comprendre pourquoi, en temps de crise, la question du pouvoir tend à se recentrer sur la décision et l’ennemi.
https://www.babelio.com/livres/Schmitt-La-notion-de-politique/30572
Carl Schmitt – Théologie politique
Sur le lien entre souveraineté et état d’exception, et la manière dont le droit se reconfigure dans l’urgence.
https://www.babelio.com/livres/Schmitt-Theologie-politique/30571
Démocratie, élites et désenchantement
Christopher Lasch – La Révolte des élites
Analyse précoce de la rupture entre élites globalisées et sociétés nationales, et de ses effets politiques.
https://www.babelio.com/livres/Lasch-La-Revolte-des-elites/19549
Pierre Rosanvallon – La Contre-démocratie
Sur la défiance, la surveillance et la contestation comme nouvelles formes de participation politique.
https://www.babelio.com/livres/Rosanvallon-La-Contre-democratie/10874
Capitalisme, démocratie et neutralisation du politique
Wolfgang Streeck – Du temps acheté
Analyse du contournement démocratique par la dette, les marchés et les contraintes économiques.
https://www.babelio.com/livres/Streeck-Du-temps-achete/588495
Jürgen Habermas – Après l’État-nation
Réflexion sur la crise de légitimité démocratique dans un monde globalisé.
https://www.babelio.com/livres/Habermas-Apres-lEtat-nation/122573
Information, vérité et fragilisation du débat public
Hannah Arendt – Vérité et politique
Texte fondamental sur le lien entre réalité partagée, mensonge et possibilité même de la démocratie.
https://www.babelio.com/livres/Arendt-Ve-rite-et-politique/23836
Neil Postman – Se distraire à en mourir
Sur la manière dont les médias transforment le débat public en spectacle et affaiblissent la délibération.
https://www.babelio.com/livres/Postman-Se-distraire-a-en-mourir/17872
Démocratie, technologie et alternatives
Benjamin Barber – Strong Democracy
Plaidoyer pour une démocratie plus exigeante, participative, mais consciente de ses limites.
https://www.babelio.com/livres/Barber-Strong-Democracy/394157
Audrey Tang (travaux, conférences)
Réflexions contemporaines sur démocratie numérique, transparence radicale et gouvernance distribuée.
Est-ce que vous aussi, vous l’entendez monter, cette petite musique ?
Dans les médias, évidemment. Sur les réseaux. Mais aussi de plus en plus dans des discussions entre amis.
Une musique qui dit que si nous n’arrivons plus à régler certains problèmes de société, si la France et l’Europe donnent l’impression d’être faibles, de ne plus tenir leur rang, si l’école et les hôpitaux se dégradent, si la violence semble monter, bref, si les choses ne vont pas comme on le voudrait, ce n’est pas seulement conjoncturel.
Ce serait plus profond que ça. Structurel.
Une musique qui suggère que nos systèmes ne sont tout simplement plus adaptés.
Que la démocratie, telle qu’on la pratique aujourd’hui, serait devenue trop lente, trop compliquée, trop faible, trop impuissante face aux défis actuels. Qu’à force de discuter, de temporiser, de composer, on aurait perdu la capacité de trancher. Et que la seule manière d’en finir avec ce sentiment de désordre, ce serait de remettre de l’ordre.
Tant pis, au passage, si quelques vieilles règles jugées inefficaces doivent sauter. Ça suffit.
Je l’entends quand certains regardent la Chine avec admiration et disent : au moins là-bas, ça décide. Au moins, ça avance.
Je l’entends quand certains regardent l’Amérique de Trump et se réjouissent, plus ou moins ouvertement, d’un retour à la puissance assumée, à l’action, à la clarté. Et tant pis pour l’état de droit, tant pis pour la vérité, parce qu’après tout, il fallait bien en passer par là.
Je l’entends aussi quand certains présentent les actions de Nayib Bukele, le président du Salvador, auto-proclamé « dictateur le plus cool du monde », comme une politique de bon sens.
Certes, il a considérablement affaibli les contre-pouvoirs. Certes, il a fait emprisonner près de 100 000 hommes dans des camps, parmi lesquels nombre d'innocents. Mais n’a-t-il pas, disent-ils, libéré sa population de la violence des cartels ? N’est-ce pas le prix à payer pour ramener l’ordre et la sécurité ?
Et je l’entends, tout simplement, quand certains finissent par dire que la démocratie est peut-être une belle idée… mais qu’elle ne fonctionne plus vraiment. Ou plus assez.
Cette musique n’est pas marginale.
Et cette tentation de « passer à autre chose » est très concrète. Ce n’est pas juste une impression personnelle.
Dans plusieurs pays occidentaux, une part croissante de la population dit explicitement préférer un pouvoir plus fort, plus direct, jugé plus efficace, quitte à sacrifier une partie des procédures démocratiques.
Pas forcément par rejet des libertés. Mais par lassitude, par fatigue, par sentiment que le système actuel n’arrive plus à trancher.
En France, par exemple, 73 % des Français disent souhaiter « un vrai chef pour remettre de l’ordre », selon un sondage du Cevipof. Et d’après une enquête Ipsos, environ un quart des Français interrogés ne pensent plus que la démocratie soit le meilleur système, en particulier chez les moins de 30 ans.
Cette musique, c’est celle d’un doute qui traverse aujourd’hui beaucoup de sociétés démocratiques, c’est celle d’un ras-le-bol, d’une inquiétude.
Le symptôme d’une combinaison de peurs, parfois instrumentalisées et exagérées, parfois bien réelles. Et personnellement, je ne m’en sens pas immunisé.
Moi aussi, j’ai parfois le sentiment que nos régimes sont à bout de souffle. Que notre classe politique n’est pas à la hauteur, ni assez compétente, ni assez responsable, ni vraiment représentative. Que l’Union européenne est illisible. Qu’il y a trop de contraintes ici, pas assez là. Qu’on manque de cap. Moi aussi, je m’interroge sur l’insécurité, sur l’identité des peuples, sur ce qui les met en mouvement, ce qui les tend ou, au contraire, les apaise. Sur notre souveraineté, aussi. Et oui, moi aussi, je me surprends à me demander s’il ne faudrait pas sacrifier une partie des grands principes qui sous-tendent nos démocraties pour enfin faire bouger les choses. S’il ne serait pas, au fond, assez confortable de faire confiance à un homme providentiel, à la De Gaulle en 1958. Être pris en main, rassuré, dirigé, se sentir protégé. C’est tentant. Parce que ce flou permanent, cette complexité démocratique, c’est aussi fatigant.
Mais je me méfie de ce sentiment. Parce que je sais que l’histoire nous enseigne que faire confiance à celles et ceux qui promettent l’ordre avant tout n’est jamais sans conséquences.
Dans cet épisode, je vous propose donc d’essayer de comprendre un peu mieux cette musique. Parce qu’à force de l’entendre, elle finit par nous bercer.
Je vais explorer quelques questions simples en apparence :
– À quoi sert, au fond, un régime politique ?
– Pourquoi et comment différents types de régimes se succèdent dans l’histoire ?
– Qu’est-ce qui fait qu’à un moment, ça ne marche plus ?
– Ce que la démocratie a de particulier, ce qui l’a fait apparaître, ce qui fait sa force, et aussi ce qui la fait dysfonctionner.
– Et enfin, cette tentation autoritaire contemporaine : pourquoi elle nous parle, ce qu’elle promet, et les risques qu’elle fait courir.
Comme toujours, je ne suis pas là pour vous dire quoi penser. Ce sont des questions complexes, débattues par les spécialistes. Elles touchent au droit, aux idéologies, aux émotions, et à ce qui les façonne.
J’ouvre des pistes de réflexion, forcément biaisées, forcément incomplètes. À vous de vous en saisir pour affiner votre propre regard.
Générique.
I. À quoi servent les régimes politiques, au fond ?
Avant de parler de démocratie, d’autoritarisme ou de changement de régime, il faut revenir à une question beaucoup plus simple. À quoi sert un régime politique, concrètement ?
À quoi ça sert, quand on enlève les discours, les symboles, les grands idéaux affichés ?
La réponse est moins noble qu’on ne l’imagine souvent. Un régime sert d’abord à organiser le pouvoir. À décider qui commande, comment, au nom de qui, et avec quelles limites. Quand il y en a.
Dit autrement, un régime propose, ou impose, une manière de transformer des rapports de force bruts, toujours présents dans toute société, en un ordre à peu près stable. Et là, c’est important de préciser une chose. Stable ne veut pas dire juste. Stable veut dire organisé. Prévisible. Pendant un temps au moins.
Si on prend un peu de hauteur, cette stabilité repose toujours sur la gestion de contradictions profondément humaines. Des contradictions entre des désirs qui coexistent partout, à toutes les époques.
Le désir d’ordre.
Le désir de liberté.
Le désir d’égalité.
Le désir de sécurité.
Le désir de reconnaissance.
Et le désir de puissance, aussi.
Ces désirs ne s’additionnent pas gentiment. Ils entrent en concurrence. Parce qu’on ne peut pas tout avoir en même temps. Et parce que personne n’est d’accord sur ce qu’il faudrait prioriser. Selon ses valeurs, ses croyances, sa vision de ce qui est juste. Et aussi selon sa place dans la hiérarchie sociale.
Pour que ce soit bien clair, prenons quelques exemples très concrets.
Plus d’ordre implique presque toujours moins de liberté. Au moins pour certains.
Quand un État renforce la police, étend la surveillance ou durcit les peines au nom de la sécurité, ce ne sont jamais les mêmes groupes qui en paient le prix.
L’ordre rassure une partie de la société, pendant que d’autres voient leurs marges se réduire.
À l’inverse, plus de liberté fragilise toujours un peu l’ordre.
Tolérer la dissidence, accepter des modes de vie divergents, laisser s’exprimer les conflits rend la société plus ouverte, mais aussi plus imprévisible.
La liberté produit du bruit. De l’incertitude. Parfois de l’instabilité.
Plus d’égalité, de son côté, remet forcément en cause des positions acquises.
Redistribuer, corriger des inégalités, ouvrir l’accès à des ressources ou à des statuts, ça signifie que certains perdent des avantages qu’ils considéraient souvent comme légitimes, voire naturels.
L’égalité n’est jamais politiquement neutre.
Et puis il y a la puissance collective.
Construire une industrie stratégique, une armée crédible, une souveraineté énergétique ou technologique suppose de choisir, d’investir massivement, de travailler plus et mieux, d’imposer des priorités.
La puissance a toujours un coût.
Et ce coût est rarement réparti de manière parfaitement équitable.
Ca nous amène à considérer la vraie question politique, celle du choix.
Qu’est-ce qu’on veut privilégier, en tant que société ?
Est-ce qu’on accepte de rogner un peu sur la liberté pour plus de sécurité ?
Est-ce qu’on protège d’abord les droits, les minorités, les contre-pouvoirs, quitte à ralentir l’ensemble ?
Est-ce qu’on privilégie le bien-être de la majorité, même si cela implique de sacrifier certains individus ou certains groupes au passage ?
Ces questions n’ont jamais eu de réponse évidente. Elles traversent toute la philosophie politique.
Par exemple, d’un côté, il y a ceux qui estiment qu’une société juste est celle qui maximise le bien-être du plus grand nombre.
C’est la tradition utilitariste, héritée de Jeremy Bentham ou de John Stuart Mill.
De l’autre, ceux qui considèrent qu’il existe des principes non négociables. Qu’on ne peut pas sacrifier un innocent, même si cela améliore le sort du groupe. Qu’il y a des lignes à ne pas franchir.
C’est la tradition déontologique, qu’on associe notamment à Kant, et plus largement à l’idée de droits fondamentaux.
Ce désaccord n’a jamais été tranché. Et c’est précisément pour ça qu’il est politiquement explosif.
Mais ne nous égarons pas ici, ce qui m’importe, ce n’est pas de résoudre ces débats philosophiques. Et si ça vous intéresse je vous de quoi vous amusez dans les notes de l’épisode.
Ce qui m’importe c’est de comprendre ce que font les régimes politiques avec ces tensions.
Et de fait aucun régime ne les supprime. Aucun. Il les arbitre. Plus ou moins bien. Plus ou moins longtemps.
Un régime tient tant que ces arbitrages sont compris, tolérés, acceptés, même à contrecœur. Tant que les frustrations ne s’accumulent pas toujours du même côté. Tant que les pertes sont perçues comme temporaires, ou au moins partagées.
Et surtout, un régime tient tant qu’il parvient à rendre la domination supportable.
Parce que c’est aussi ça, un régime politique. Une manière de faire accepter que certains décident plus que d’autres. Que certains disposent de plus de ressources, de plus de pouvoir, de plus de marges.
La question politique n’a jamais été de supprimer la domination. Elle a toujours été de savoir comment elle s’exerce, au profit de qui, et jusqu’où.
C’est pour ça que les régimes politiques ne peuvent pas être compris uniquement à travers leurs principes. Il faut les regarder comme des dispositifs fonctionnels, conçus pour contenir des tensions qui, sans cela, finiraient par exploser.
Quand un régime est stable, c’est qu’il parvient à gérer ces tensions. Mais cette stabilité est toujours fragile.
Toujours provisoire. Elle repose sur une série d’ajustements permanents. Institutionnels. Sociaux. Symboliques. Parfois discrets. Parfois brutaux.
Et tant que ces ajustements fonctionnent, l’ordre tient. Quand ils cessent de produire leurs effets, la fragilité devient visible.
Et, en général, ça finit par casser.
C’est exactement ce que nous montre l’étude des cycles historiques. Et c’est ce dont je vais vous parler maintenant.
II. Les cycles historiques : toujours la meme histoire
Il y a plus de deux mille ans, un historien grec, Polybe, s’est intéressé à une question assez simple: comment les régimes politiques évoluent-ils dans le temps ? Tout simple donc surtout qu’on imagine qu’il n’avait pas à sa disposition des tonnes de ressources.
Contrairement à beaucoup de philosophes de son époque, il ne cherche pas à déterminer quel régime serait le meilleur en théorie. Ce qui l’intéresse, c’est le réel. Comment les régimes naissent, comment ils se stabilisent, comment ils s’usent… et comment, finalement, ils disparaissent.
Polybe avance une idée clé, qui va traverser toute la pensée politique occidentale : chaque forme de pouvoir porte en elle les germes de sa propre dégradation. Un peu comme un être vivant donc. Quand on nait, on va forcément mourir. Ca parait assez évident dit comme ça, rien n’est éternel, mais c’est quand même intéressant, parce que vous allez voir que ça donne des schémas qui se répètent, et donc une certaine prévisibilité. Alors pourquoi? Qu’est-ce qui est prévisible. Polype nous dit que ce sont les humains. Un régime ne tombe in fine pas par accident, pas par complot, mais parce que les humains sont ce qu’ils sont. Des êtres traversés par des passions assez constantes : l’ambition, la peur de perdre, la recherche de privilèges, le refus de la limite.
Et ces passions peuvent être contenues un temps par des institutions, des règles, des équilibres. Mais elles finissent toujours par ressurgir.
Polybe appelle cette dynamique l**’anacyclose**.
Un cycle dans lequel les régimes politiques se succèdent en se transformant les uns les autres.
Alors, comment ça se passe, concrètement ?
Le cycle commence généralement par un pouvoir fort, une monarchie, qui émerge après une période de chaos. Guerre civile, désordre, fragmentation, violence.
Dans ce contexte, un pouvoir centralisé rétablit l’ordre, impose des règles, tranche, protège. Et c’est accepté parce que le chaos, ça fatigue tout le monde.
Et tant que ce pouvoir sert l’intérêt collectif, tant que le souverain apparaît comme raisonnable, compétent, “éclairé” dirait-on aujourd’hui, il continue d’être accepté. C’est autoritaire, certes, mais tant que ça fonctionne, tant que la sécurité revient, que les choses se stabilisent, on ne se plaint pas trop.
Puis, avec le temps, presque toujours, cette monarchie se transforme en tyrannie.
Pourquoi me direz-vous ?
Parce que le même pouvoir concentré qui permettait d’arbitrer, finit par servir avant tout à se maintenir.
Le souverain dépend de moins en moins des autres, supporte de moins en moins la contestation, confond progressivement l’intérêt collectif avec sa propre survie politique. C’est très humain, le pouvoir monte à la tête et quand on en a c’est difficile d’accepter de se restreindre.
Et donc l’ordre change de nature. Il ne sert plus à réguler les tensions, mais à les écraser. L’arbitrage disparaît, la domination devient une fin en soi.
À ce stade, forcément, le souverain n’est plus très aimé. Il se déplace entouré de gardes, s’isole, se méfie, fait goûter ses plats avant de les manger. Et en général, ce n’est pas bon signe.
Face à cette tyrannie, les élites finissent par se rebeller. Parfois en s’appuyant sur le peuple, parfois en l’instrumentalisant.
Le souverain est renversé, et on instaure alors une aristocratie : le pouvoir de ceux qui sont censés être les meilleurs, les plus compétents, les plus vertueux. Là encore, le régime fonctionne tant que cette caste gouverne en tenant compte de l’intérêt général.
Mais, là encore, le même mécanisme se reproduit.
L’aristocratie se dégrade progressivement en oligarchie. L’élite finit par se croire indispensable. Elle gouverne moins pour le collectif que pour sa propre reproduction. Elle protège ses avantages, ferme l’accès au pouvoir, verrouille les positions. Les arbitrages deviennent systématiquement biaisés.
Le peuple, exaspéré, finit alors par renverser l’oligarchie. Ou plus exactement, il rend l’ordre existant intenable, ouvrant la voie à une démocratie dont les formes seront, là encore, largement dessinées par de nouvelles élites. In fine ce sont toujours les élites qui pilotent, on va y revenir.
Le pouvoir est censé revenir au plus grand nombre. Mais cette démocratie peut, elle aussi, se dégrader, lorsqu’elle bascule dans ce que Polybe appelle l’ochlocratie : le pouvoir de la foule. Une situation où la décision collective est dominée par la passion, la démagogie, la recherche de gains immédiats, et où la volonté générale cesse d’être réellement générale.
À ce stade, l’ordre ne tient plus. Le conflit devient permanent. Et de cette instabilité émerge, à nouveau, un homme fort, chargé de rétablir l’ordre.
Retour à la case départ. Le cycle recommence.
Ce que Polybe décrit ici n’est pas une fatalité mécanique, ni une prophétie. C’est une logique d’usure. Un déséquilibre progressif entre les principes affichés d’un régime et les pratiques réelles du pouvoir.
Ce qu’il montre, c’est que la stabilité d’un régime repose moins sur la vertu supposée de ses dirigeants que sur sa capacité à se corriger lui-même, à limiter les concentrations de pouvoir, à absorber ses propres excès.
Lorsqu’un régime perd cette capacité d’autorégulation, il peut encore durer longtemps. Mais il entre dans une phase de vulnérabilité structurelle.
Pour compléter cette lecture, il faut mentionner un autre grand penseur des cycles politiques : Ibn Khaldoun, historien et penseur du monde arabo-musulman du XIVᵉ siècle.
Là où Polybe observe surtout les formes politiques, Ibn Khaldoun s’intéresse à l’énergie sociale qui les rend possibles.
Pour lui, les pouvoirs ne tiennent pas seulement par des institutions, mais par une cohésion collective active, une capacité à faire corps. Et cette énergie, une fois le pouvoir installé, tend presque toujours à se dissiper.
Autrement dit, un régime peut gagner en administration, en organisation, en contrôle. Mais il perd peu à peu ce qui rendait l’ordre acceptable, vécu, incarné. Là encore, il ne s’agit pas de décadence morale, mais de fatigue structurelle. Quand on vit en France, où le nombre de lois, de couches administratives, ne cesse d’augmenter jusqu’à en devenir quasiment incompréhensible, on voit de quoi on parle.
Chez Polybe comme chez Ibn Khaldoun, le changement de régime ne survient donc jamais comme un événement isolé. Il résulte d’un désalignement progressif entre trois éléments : les institutions, les rapports de force réels, et les croyances qui rendent ces rapports acceptables.
Tant que ces trois dimensions restent à peu près synchronisées, le régime tient. Lorsqu’elles se décalent durablement, le régime peut continuer à fonctionner formellement, mais il cesse d’être crédible.
Alors oui, il y a des cycles.
Tous les régimes, quelle que soit leur forme, finissent par s’user. Mais il faut préciser une chose essentielle, souvent sous-estimée et indispensable pour comprendre la mécanique générale. Dans ces moments de bascule, ce ne sont pas d’abord les peuples qui décident comme nos cours d’histoire nous laissent parfois le croire. Ce sont presque toujours les élites. Ceux qui établissent les règles, qui contrôlent les leviers, qui arbitrent les conflits internes, et qui, le moment venu, sifflent la fin de la partie et l’ouverture d’une autre.
Pour comprendre ce que nous vivons aujourd’hui, il faut donc regarder de très près ce qui se passe à ce niveau-là. La manière dont le pouvoir est exercé, disputé, partagé ou verrouillé entre ceux qui le détiennent. Et pour ça, il faut faire un détour par un autre penseur clé.
Pour ne pas vous perdre, on ouvre une 3eme partie : Le pouvoir, les élites et les rapports de force
III. Quand un régime commence réellement à se fatiguer. Le pouvoir, les élites et les rapports de force
Si on accepte l’idée qu’un régime tient tant que ses arbitrages restent supportables, alors une question s’impose assez vite : qui arbitre réellement quand les tensions montent ?
Et la réponse ne se trouve ni uniquement dans les textes, ni dans les principes, ni même dans la rue, du moins au départ. Elle se trouve dans la manière dont le pouvoir est exercé, partagé, et surtout disputé entre ceux qui le détiennent.
Un régime commence à vaciller quand ceux qui le dominent cessent de tenir ensemble. Quand les élites n’arrivent plus à coopérer, à se contenir, à accepter la perte temporaire de positions ou d’avantages. Quand les règles qu’elles ont elles-mêmes construites deviennent trop coûteuses à respecter. Quand, pour le dire simplement, ça s’embrouille dans les palais.
À ce moment-là, le problème n’est plus seulement un problème de légitimité démocratique ou de colère populaire. C’est un problème de fonctionnement interne du pouvoir.
Pour comprendre ça on va faire appelle à un certain Vilfredo Pareto, économiste et sociologue italien du début du XXᵉ siècle.
Pareto, entre deux plats de pâte, s’est intéressé à une question assez dérangeante, mais très éclairante (et j’attends avec impatience vos emails outrés sur ce stéréotype italien des pâtes). Sa question c’est: pourquoi les élites changent-elles sans cesse, alors que le pouvoir, lui, reste toujours concentré entre quelques mains ?
Je précise au passage, parce que le mot est piégé : quand on parle d’« élites » ici, on ne parle pas de la crème de la crème, ni des gens les plus brillants ou les plus vertueux. On parle simplement de ceux qui détiennent durablement le pouvoir politique, économique et institutionnel. Les dominants, quoi.
Pour Pareto, une élite gouvernante tient tant qu’elle se renouvelle. Tant qu’elle intègre de nouveaux groupes, qu’elle accepte une certaine circulation des positions, qu’elle tolère que certains montent pendant que d’autres descendent.
En revanche, lorsqu’elle se ferme, lorsqu’elle homogénéise ses trajectoires, lorsqu’elle transforme le pouvoir en propriété privée et héréditaire, elle devient à la fois plus rigide et plus conflictuelle. Et paradoxalement, plus elle cherche à se protéger, plus elle se fragilise.
Pourquoi ?
Parce que le pouvoir n’est jamais seulement une relation entre dominants et dominés. C’est aussi, et surtout, une relation entre dominants eux-mêmes. Une lutte permanente pour l’accès aux ressources, aux postes, aux décisions.
Tant que cette lutte est régulée, le régime tient. Lorsqu’elle devient ouverte, brutale, existentielle, le régime commence à se vider de l’intérieur.
OSS 117 dirait : « Je connais cette théorie. »
Pour rendre tout ça plus concret, faisons un détour par un cas d’école. Un classique absolu. La fin de la République romaine, au Ier siècle avant notre ère.
À ce moment-là, si l’on se contente de regarder les façades institutionnelles, tout semble encore fonctionner. Le Sénat est bien là. Les magistratures existent. Les procédures sont respectées. On continue à faire de grands discours sur la vertu républicaine, la tradition, l’équilibre des pouvoirs. Bref, sur le papier, la République romaine coche toutes les cases. Si Rome était une démocratie moderne, elle aurait encore un site officiel, un organigramme et une belle charte de valeurs.
Sauf que derrière la façade, tout est en train de se fissurer.
Pourquoi ? Parce que les conditions matérielles du pouvoir ont radicalement changé. Les conquêtes ont transformé Rome en superpuissance. Elles font affluer des richesses immenses, des provinces entières à administrer, et surtout des armées professionnelles qui ne sont plus vraiment loyales à une abstraction appelée “la République”, mais à des hommes bien concrets. Des généraux. Avec un nom, un visage, des légions qui leur doivent leur solde, leurs terres, parfois leur survie.
À partir de là, le pouvoir cesse d’être une affaire de carrière politique bien gérée au Sénat. Il devient une affaire de fortunes colossales, de clientèles personnelles, de territoires contrôlés à long terme. Disons-le autrement : on ne joue plus dans la même division.
Avant, perdre une bataille politique, c’était désagréable, mais pas dramatique. On rentrait chez soi, on ruminait un peu, on revenait quelques années plus tard. Maintenant, perdre, c’est risquer l’exil, la ruine, parfois l’assassinat. C’est voir son adversaire s’installer durablement, verrouiller les postes, capter les ressources, garder les légions, et au passage réécrire les règles du jeu.
Autrement dit, on n’est plus dans une compétition feutrée entre sénateurs en toge qui se chamaillent à coups de discours. On est dans un jeu où la sortie peut être définitive. Et quand perdre devient une menace existentielle, le compromis cesse d’être rationnel.
Dans ce contexte, les élites romaines ne parviennent plus à se contenir. Chacun soupçonne l’autre de vouloir aller trop loin, de transformer une victoire ponctuelle en domination permanente. Les règles existent toujours, bien sûr. On continue à les invoquer. Mais on commence à les contourner, puis à les tordre, puis à les oublier. Pas par idéologie. Par calcul. Parce que personne ne veut être le dernier naïf à respecter les règles pendant que les autres s’en affranchissent.
Le peuple, dans cette histoire, ne renverse pas la République. Il assiste à son épuisement. Les institutions sont encore debout, mais plus personne ne croit vraiment qu’elles suffisent à gouverner un empire devenu immense, instable et conflictuel. La République n’est pas renversée. Elle devient insuffisante.
Et quand apparaît la figure d’Auguste, il ne surgit pas comme un tyran caricatural, moustache noire et regard fou. Il arrive comme une solution pratique. Celui qui remet de l’ordre, sécurise les frontières, stabilise le pouvoir. Et il le fait intelligemment, en conservant une partie des formes républicaines, en laissant le Sénat exister, en respectant les apparences. Officiellement, la République tient encore.
D’ailleurs, les historiens font traditionnellement commencer l’Empire en 27 avant J.-C. Mais dans les faits, le basculement est déjà largement consommé.
La République ne disparaît pas brutalement. Elle est dépassée.
Et ce schéma, on le retrouve sous des formes différentes à travers l’histoire. Les régimes ne tombent pas seulement parce qu’ils sont injustes ou impopulaires. Ils tombent parce qu’ils deviennent ingouvernables. Parce que les élites n’arrivent plus à arbitrer leurs propres conflits. Parce que le pouvoir cesse d’être un bien collectif administré en commun pour devenir un enjeu de lutte permanente.
À ce moment-là, la tentation d’un pouvoir plus concentré, plus personnel, plus lisible gagne du terrain. Non pas forcément par goût de l’autorité, mais par fatigue du désordre. Par épuisement face à un système qui n’arrive plus à se contenir lui-même.
Comprendre cette dynamique est essentiel pour lire le présent. Elle permet de sortir d’une vision naïve des transitions politiques. Elle montre que les bascules de régime ne sont jamais purement morales. Elles sont d’abord structurelles, liées aux rapports de force, aux intérêts, et à la capacité – ou à l’incapacité – des dominants à se contenir eux-mêmes.
Donc si je résume :
Un régime sert à arbitrer entre des désirs contradictoires, entre des intérêts contradictoires, et il se met en place pour stabiliser les choses.
Ca tient en place tant que les élites y trouvent leur compte et que le peuple ne se met pas trop en colère.
Et inévitablement tout régime quelle qu’en soit sa forme finit par se dérégler, parce que les humains sont des humains…
Je vous propose maintenant de nous intéresser de plus près à cette forme de régime qu’on connait pas mal chez nous en France et plus largement en occident, cette forme dont on est plutôt content et qu’on a d’ailleurs voulu exporté parce qu’on se dit que quand même c’est pas mal. J’ai nommé la démocratie.
qu’est-ce qui rend la démocratie particulière dans cette histoire ? Pourquoi ce régime-là a-t-il émergé, pourquoi il a relativement bien fonctionné pendant un temps, et pourquoi aujourd’hui il semble, lui aussi, entrer dans une zone de fatigue ?
Je vous invite à écouter tout ça dans la deuxième partie de cet épisode Pause à rallonge.
——
Ceci est la deuxième partie de ma petite dissertation sur la démocratie, la tentation autoritaire et plus largement les changements de régime. Ecoutez d’abord la première partie si ce n’est pas encore fait. Et sinon on reprend avec la partie 4 : la démocratie comme compromis historique.
IV. La démocratie comme compromis historique
L’histoire, ne sert pas à prédire l’avenir. Elle sert à se situer, à prendre du recul, à éviter de croire que ce que nous vivons est totalement inédit.
C’est pour ça que je suis passé assez vite sur la démocratie jusqu’ici : non pas parce qu’elle serait secondaire, mais précisément pour qu’on puisse maintenant y revenir avec les bons outils, et comprendre ce qui la traverse.
Avant d’aller plus loin, il faut donc poser quelques bases. Très simplement.
Démocratie vient du grec dêmos, le peuple, et kratos, le pouvoir. Littéralement, le pouvoir du peuple. Mais cette définition est trompeuse si on la prend au pied de la lettre.
La démocratie n’a jamais signifié que “le peuple gouverne directement”, en permanence, ni que tout se décide à la majorité dans une sorte d’assemblée permanente.
Cette idée-là, c’est ce que les Grecs appelaient déjà l’ochlocratie, le pouvoir de la foule, dominé par l’émotion, la démagogie, la pression immédiate. Et ils s’en méfiaient profondément, notamment parce qu’une foule est moutonnière, manipulable, en dans le faits rarement équipée pour arbitrer des sujets complexes dans le temps long.
La démocratie moderne n’est donc pas le règne direct du peuple. C’est un système de médiations, de représentations, de procédures, de filtres. Un système qui organise la participation du peuple sans lui confier un pouvoir immédiat et absolu. Et surtout, un système qui cherche à limiter autant les abus des dirigeants que ceux de la majorité.
Il faut aussi rappeler une chose essentielle : il n’existe pas une démocratie, mais des démocraties. Des formes très différentes selon les pays, les époques, les cultures politiques. Démocraties parlementaires, présidentielles, fédérales, centralisées. Démocraties plus ou moins libérales, plus ou moins illibérales. Le terme recouvre une grande diversité de régimes concrets, parfois très éloignés les uns des autres.
Nous, en France, on vit en démocratie libérale, c’est-à-dire une démocratie qui ne se contente pas d’organiser des élections, mais qui encadre le pouvoir par des règles, des droits fondamentaux et des contre-pouvoirs, pour éviter qu’une majorité, même élue, puisse tout décider sans limites.
Quand on parle ici de démocratie libérale, on ne parle donc pas d’un idéal abstrait ou d’un horizon moral universel. On parle d’un compromis historique très précis, apparu dans des contextes eux-mêmes très particuliers.
La démocratie libérale émerge dans des sociétés marquées par la violence politique, les guerres civiles, les affrontements religieux, les révolutions. Des sociétés qui ont appris, souvent dans le sang, ce que coûte soit l’absence de règles communes, soit la concentration excessive du pouvoir. Ce que cherchent alors les fondateurs de ces régimes, ce n’est pas la société parfaite. Ce n’est pas l’harmonie. C’est quelque chose de beaucoup plus modeste, et en même temps très ambitieux : prévenir le pire.
Autrement dit, éviter qu’un groupe confisque durablement l’État, éviter que les passions collectives s’emballent, éviter qu’un pouvoir sans limites fasse n’importe quoi.
La démocratie libérale est donc, avant tout, un système de méfiance organisée.
Méfiance envers les dirigeants, qu’on empêche de concentrer trop de pouvoir.
Méfiance envers les foules, qu’on canalise à travers la représentation et le droit.
Méfiance envers les élites elles-mêmes, qu’on soumet à des règles, à des contre-pouvoirs, à la possibilité d’alternance.
D’où la séparation des pouvoirs. D’où la lenteur volontaire des procédures. D’où la multiplication des institutions, des médiations, des garde-fous juridiques.
Gouverner devient compliqué, frustrant, parfois exaspérant. Et ce n’est pas une anomalie, ou une dérive du système comme on l’entend parfois. C’est son cœur, c’est fait exprès.
Ce compromis permet néanmoins quelque chose de précieux : transformer des conflits potentiellement violents en désaccords institutionnalisés. Faire en sorte que les tensions entre ordre, liberté, égalité et puissance ne se règlent pas par la force, mais par des arbitrages réversibles. Et « réversibles », c’est le mot clé.
On peut se tromper. On peut corriger. On peut changer de cap sans renverser le régime.
Moins d’efficacité, moins de vitesse donc, mais aussi moins de violence et surtout la possibilité de faire marche arrière, de changer quand on n’est pas content du résultat.
Pendant longtemps, ce compromis fonctionne plutôt bien. Pas parce qu’il serait moralement supérieur, mais parce qu’il est porté par un contexte matériel favorable. Un contexte de croissance économique, d’abondance énergétique, d’expansion industrielle, parfois coloniale.
Les conflits existent, mais ils sont amortis. Les sacrifices peuvent être présentés comme temporaires. Les frustrations comme appelées à être corrigées plus tard.
La démocratie libérale devient alors un régime de promesses crédibles. Promesse de droits. Promesse de protection. Promesse de mobilité sociale. Promesse, surtout, que les injustices peuvent être contestées et corrigées sans passer par la violence.
Elle ne supprime ni la domination, ni les élites, évidemment. Mais elle les rend contestables. Elle organise leur renouvellement, ce qui comme on l’a vu est important. Elle entretient l’idée, vraie ou fausse, qu’on peut monter, accéder, participer. Rêve américain, ascenseur républicain, etc…
Autre élément central de sa stabilité : la centralité du politique.
Les décisions structurantes se prennent dans des espaces identifiables. Les responsables sont nommables. Les choix sont discutables. Les alternances, même imparfaites, redistribuent temporairement le pouvoir. Le système est loin d’être juste, mais il est lisible. Et tant qu’un régime reste lisible, tant que ses arbitrages peuvent être compris, même contestés, il tient.
Bien sûr, ce compromis a toujours été fragile. Il suppose une certaine homogénéité sociale et culturelle. Il repose sur des hiérarchies réelles, parfois très marquées. Il dépend de conditions matérielles favorables et d’un ordre international relativement stable. Mais tant que ces fragilités restent contenues, la démocratie libérale conserve une capacité essentielle : celle de se corriger sans se renverser.
Alors quel est aujourd’hui le soucis. Pourquoi certains ne sont plus aussi sûr que la démocratie libérale fonctionne bien, voire que c’est un bon modèle pour notre époque et ses défis ?
Le problème ce n’est donc pas que la démocratie libérale soit imparfaite. Elle l’a toujours été. Le problème, c’est que les conditions qui rendaient ce compromis opérant se transforment profondément. Et c’est ce glissement lent, cumulatif, souvent invisible, qui explique pourquoi ce système, longtemps efficace pour arbitrer des tensions contradictoires, commence à donner le sentiment d’arriver à bout de souffle.
C’est ce basculement que nous allons maintenant examiner.
V. Pourquoi ce compromis dysfonctionne de plus en plus aujourd’hui
Si on revient maintenant au présent avec cette grille de lecture en tête, une chose apparaît assez nettement. Ce qui se dérègle dans nos démocraties, ce n’est pas d’abord le principe du suffrage, ni même l’existence formelle des libertés publiques. C’est quelque chose de plus subtil, mais de plus structurant : la capacité du système à arbitrer lisiblement des tensions devenues beaucoup plus dures, plus visibles, plus coûteuses politiquement.
Autrement dit, la démocratie continue de fonctionner sur le papier, mais elle peine de plus en plus à produire des décisions perçues comme légitimes, compréhensibles et efficaces face aux contraintes actuelles.
Et on peut identifier au moins trois grandes transformations qui expliquent ce décalage.
La première concerne la transformation profonde de l’espace public.
La démocratie libérale s’est construite dans un monde de médiations lentes. Les partis politiques, les syndicats, la presse, les débats parlementaires, les corps intermédiaires jouaient un rôle central. Ils filtraient les colères, traduisaient les intérêts, hiérarchisaient les conflits.
Ils permettaient de transformer des frustrations diffuses en revendications structurées, négociables, intégrables dans le jeu politique.
Aujourd’hui, une grande partie de ces filtres s’est affaiblie, voire a disparu.
Les réseaux sociaux, l’information en continu, la logique algorithmique ont profondément modifié la structure des opinions. Les désaccords deviennent visibles immédiatement, souvent dans leur forme la plus brute. Les positions se radicalisent plus vite. La nuance coûte cher. Le conflit devient permanent, exposé en temps réel, sans toujours déboucher sur une décision.
Tout devient politique, mais sans que le politique ne parvienne réellement à reprendre la main.
C’est ce que certains auteurs contemporains ont appelé l’hyperpolitique. Une situation où chaque mot, chaque arbitrage, chaque geste est instantanément commenté, contesté, amplifié, mais où, paradoxalement, la capacité à trancher collectivement s’affaiblit. Pas parce que les citoyens seraient indifférents ou apathiques, mais parce que les médiations traditionnelles qui permettaient de transformer le conflit en décision se sont érodées.
Le conflit ne disparaît pas. Il se déverse directement dans l’espace public, sans filtre, sans traduction, sans hiérarchisation.
C’est ce qui permet de comprendre, par exemple, pourquoi un mouvement comme celui des Gilets jaunes, malgré son ampleur, sa durée et son intensité, n’a pas débouché sur une traduction politique stable. Faute de structures capables de faire cristalliser des revendications, de les hiérarchiser, de les transformer en arbitrages concrets, le conflit est resté à l’état brut, puissant, mais difficilement gouvernable.
Le débat devient permanent, mais la décision devient de plus en plus coûteuse, fragile et risquée politiquement.
Tout est politisé, et pourtant le politique peine à reprendre la main.
Gouverner devient extrêmement difficile. Chaque arbitrage produit immédiatement des perdants très visibles. Chaque compromis est dénoncé comme une trahison. La temporalité longue, pourtant essentielle au fonctionnement démocratique, devient presque impossible à tenir.
À la transformation de l’espace public s’ajoute un deuxième facteur, plus matériel: la fin de l’abondance.
Comme on l’a vu, la démocratie libérale s’est largement développée dans un monde de croissance économique, d’énergie relativement abondante et d’expansion matérielle suffisante pour amortir les conflits. Quand la richesse augmente, les arbitrages sont moins douloureux. Les frustrations peuvent être repoussées. Les inégalités apparaissent plus supportables parce que chacun peut encore espérer monter d’un cran, ou au moins ne pas descendre.
Cette donne est en train de changer profondément.
Ralentissement économique, contraintes énergétiques, tensions géopolitiques, crise écologique, on connaît le tableau. Les arbitrages deviennent plus visibles, plus conflictuels. Redistribuer signifie de plus en plus clairement retirer à certains. Protéger implique de prioriser. Décider, désormais, c’est assumer des pertes nettes, identifiables, parfois irréversibles, ou repousser encore les choix difficiles en accumulant de la dette, financière, sociale ou écologique, qui finit toujours par se payer d’une manière ou d’une autre.
Et lorsque les ressources se tendent, une autre dynamique apparaît, plus délicate à aborder mais impossible à évacuer : la question de la cohésion du groupe politique lui-même.
La démocratie libérale suppose l’existence d’un “nous” minimal. Pas une homogénéité parfaite, ni une identité figée, mais un socle commun suffisant pour que le désaccord reste supportable, pour que la décision collective, même frustrante, reste acceptable. Autrement dit, elle suppose que l’on accepte de perdre parfois au nom d’un ensemble dans lequel on se reconnaît encore.
Or, lorsque les trajectoires se bloquent, lorsque l’ascenseur social donne le sentiment de ne plus fonctionner, lorsque les arbitrages portent sur des ressources perçues comme vitales, ce socle devient plus fragile. Les différences culturelles, sociales, religieuses ou normatives, qui pouvaient coexister relativement paisiblement en période d’abondance, prennent alors une charge politique beaucoup plus lourde.
La question implicite n’est plus seulement “que décide-t-on ?”, mais “pour qui ?”, “au nom de qui ?”, et parfois même “avec qui ?”.
Ce n’est pas tant la diversité en elle-même qui pose problème que le fait de devoir arbitrer des priorités vitales dans un groupe qui ne partage plus les mêmes attentes fondamentales, ni la même vision de ce qui est juste, acceptable ou légitime. Là où l’abondance permettait de lisser ces désaccords, la rareté oblige à choisir, et ces choix deviennent explosifs parce qu’ils touchent à l’appartenance, à la reconnaissance, au sentiment de compter ou non dans le collectif.
Dans ce contexte, la promesse démocratique devient plus difficile à tenir, parce qu’elle suppose précisément ce que la situation met à l’épreuve : la capacité à accepter des décisions collectives prises au nom d’un ensemble dans lequel on se reconnaît de moins en moins.
Troisième facteur enfin : le déplacement du pouvoir réel.
Une part croissante des décisions qui structurent nos vies se prend désormais dans des espaces difficiles à identifier, à contester ou à contrôler démocratiquement. Institutions indépendantes, normes juridiques, marchés financiers, entreprises technologiques, chaînes de valeur mondialisées. Le pouvoir n’a évidemment pas disparu mais il s’est déplacé.
Pour beaucoup de citoyens, le politique donne alors le sentiment de décider sur des marges étroites, sous des contraintes déjà fixées ailleurs. Les élections continuent d’avoir lieu, mais l’espace du choix perçu se réduit. La participation devient plus coûteuse psychologiquement, pour des effets incertains. On se dit « à quoi bon ».
Pareto l’a expliqué, le jeu des élites a toujours structuré les régimes politiques.
La différence aujourd’hui, c’est qu’il se déroule de plus en plus à découvert, avec des règles perçues comme asymétriques, et des coûts qui ne sont plus partagés de manière crédible.
Dans de nombreuses démocraties, les élites politiques, économiques et administratives apparaissent de plus en plus capables de se protéger des effets négatifs des décisions collectives. Elles circulent entre sphères de pouvoir, amortissent mieux les chocs, disposent de ressources d’adaptation supérieures. Cette asymétrie nourrit un soupçon durable et légitime : celui d’un système qui demande des efforts répétés aux mêmes, tout en protégeant ceux qui arbitrent.
La confiance ne disparaît pas brutalement. Elle se fragilise. Les règles sont respectées tant qu’elles protègent, tant qu’elles semblent produire un minimum de justice et de cohérence. Quand elles donnent le sentiment de toujours faire payer les mêmes et de toujours protéger les mêmes, leur légitimité s’érode.
À ce stade, les démocraties ne s’effondrent pas.
Mais quelque chose se dérègle plus profondément.
Un écart s’installe entre ce que le système promet et ce qu’il parvient réellement à produire. Les arbitrages deviennent de plus en plus coûteux, conflictuels, difficiles à assumer. Les décisions sont prises, mais elles sont mal comprises, mal acceptées, parfois même bloquées pendant des mois ou des années, comme c’est le cas en France en ce moment, comme ça s’est passé en Belgique, en Espagne, en Hollande récemment aussi.
Ce qui se fragilise alors, ce n’est pas seulement la confiance dans les dirigeants, c’est la conviction que le système, dans son ensemble, reste la meilleure manière possible de trancher des conflits devenus plus durs. On ne rejette pas la démocratie mais on cesse d’y croire pleinement, parfois d’ailleurs sans s’en rendre compte.
Quelque chose se déplace. Les attentes changent. Le critère de légitimité glisse.
On ne demande plus d’abord du débat, de la délibération, du compromis. On attend des décisions visibles, rapides, efficaces. Un truc qui marche quoi enfin quoi.
Dans un monde plus instable, plus contraint, cette attente devient centrale.
Et c’est précisément à cet endroit que d’autres promesses commencent à paraître audibles. Pas forcément meilleures. Mais perçues comme plus adaptées à l’urgence, à la fatigue, au besoin de clarté.
C’est ce point précis que je vous propose d’examiner maintenant : pourquoi l’argument autoritaire parle à tant de mondes ?
VI. Démocratie, autorité, efficacité : pourquoi l’argument autoritaire nous parle ?
La question peut sembler provocante, mais elle circule désormais assez librement. Parfois à voix basse, parfois de manière totalement assumée.
Si la démocratie libérale paraît de moins en moins capable d’arbitrer des tensions devenues plus dures, plus visibles, plus conflictuelles, alors une autre forme de pouvoir ne serait-elle pas tout simplement mieux adaptée à notre époque ?
C’est souvent comme ça que le débat se reformule aujourd’hui. Moins en termes de principes ou de valeurs, davantage en termes de fonctionnement. Est-ce que ça décide ? Est-ce que ça agit ? Est-ce que ça protège ? Est-ce que ça tient ?
Et évidemment, cette remise en question ne se présente presque jamais comme un rejet frontal de la démocratie. On ne parle pas de dictature. On ne parle pas de régime autoritaire assumé. On parle d’ajustements, de simplifications, de bon sens. Ah le fameux bon sens, ce truc qui est une évidence pour tout le monde mais sur lequel personne n’est d’accord… J’y reviendrai, parce que comme on l’a dit les bascules politiques sont rarement spectaculaires. Elles sont souvent progressives, voire banales.
Mais avant, il faut regarder cette tentation de l’ordre pour ce qu’elle est. Et reconnaître une chose simple : l’argument autoritaire n’a rien d’irrationnel.
Les régimes autoritaires décident plus vite. Ils imposent des priorités claires. Ils mobilisent des ressources sans négociations interminables et ils produisent une direction lisible, parfois rassurante, surtout dans des contextes de crise, d’insécurité ou de fatigue collective. Plutôt cool vu comme ça.
Quand on regarde la Chine, Singapour, Dubaï, ou des figures comme Nayib Bukele au Salvador, qui revendique explicitement d’avoir suspendu certaines garanties démocratiques pour restaurer l’ordre et la sécurité, il serait malhonnête de nier que ces stratégies produisent des effets visibles.
Et dans des sociétés lassées par l’impuissance perçue des institutions, ce type de discours résonne fortement.
Il y a là une part de vérité qu’il faut accepter.
Un pouvoir concentré permet une rapidité de décision bien réelle. Parce qu’il réduit le coût du compromis, simplifie les arbitrages et rend l’action plus lisible, plus visible. Et dans certaines phases historiques, notamment après des périodes de désordre, cette capacité peut produire des résultats impressionnants, au moins à court terme. Polybe l’avait déjà observé : à certains moments du cycle, le pouvoir fort fonctionne.
Mais cette tentation de l’efficacité ne vient pas seulement “d’en bas”.
Pour comprendre cette tentation de l’efficacité, il faut ajouter une dimension souvent sous-estimée : la tension ancienne, structurelle, entre démocratie et capitalisme.
Historiquement, les élites économiques se sont toujours accommodées de la démocratie… à condition qu’elle reste contenue. Tant que le suffrage ne remet pas trop frontalement en cause la propriété, l’accumulation, la hiérarchie des richesses, ou la stabilité des règles du jeu, le compromis est acceptable. Mais dès que la démocratie devient plus inclusive, plus redistributive, plus sensible aux revendications sociales, elle commence à apparaître, du point de vue de certains acteurs économiques, comme une contrainte.
Autrement dit, le problème n’est pas la démocratie en soi, mais ce qu’elle peut produire quand elle fonctionne vraiment. Quand elle politise les inégalités. Quand elle introduit de l’incertitude dans les trajectoires économiques. Quand elle rend possible des retournements de politique, des régulations, des impôts, des normes, bref, quand elle limite la capacité de projection de la puissance économique.
Il y a glissement que l’on voit réapparaître très clairement à partir des années 1980. Comme le montre Quinn Slobodian (que vous retrouverez bientot dans Sismique), une partie du capitalisme globalisé s’est alors organisée pour se protéger du risque démocratique. Non pas en supprimant la démocratie, mais en la contournant. Par la multiplication de traités commerciaux, de juridictions d’arbitrage, d’institutions indépendantes, de règles présentées comme purement techniques, mais qui ont pour effet de soustraire des pans entiers de décision au contrôle des citoyens.
La démocratie continue d’exister, mais sur un périmètre réduit. Elle vote, mais sur des marges. Elle débat, mais dans un cadre déjà contraint. C’est ce que certains ont appelé une dynamique post-démocratique : le décor reste en place, mais le centre de gravité du pouvoir s’est déplacé.
Depuis quelques années, ce mouvement s’est encore durci, et surtout, il est devenu beaucoup plus explicite. Des figures comme Peter Thiel ne prennent même plus la peine de dissimuler cette tension. Thiel l’a formulé de manière brutale : « Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles ».
Bien sûr, la liberté dont il parle n’est pas la liberté politique au sens classique. C’est la liberté de l’entrepreneur, de l’investisseur, de l’innovateur, c’est-à-dire la liberté d’agir sans interférences collectives jugées illégitimes.
Dans cette perspective, la démocratie apparaît non plus comme un cadre protecteur, mais comme un facteur de ralentissement, voire comme un danger. Trop de contestation. Trop d’imprévisibilité. Trop de demandes contradictoires. Trop de politique. On veut des paradis fiscaux, des zones économiques spéciales, du Hong Kong, du Shenzen, du Dubai, des Îles Caïmans, et désormais des démocraties revisitées, moins libérales
Ce n’est donc pas un hasard si l’on voit émerger aujourd’hui des alliances de plus en plus décomplexées entre des discours autoritaires, des promesses d’ordre et d’efficacité, et certains intérêts économiques puissants. Trump, Milei, ou d’autres figures de ce moment politique incarnent cette convergence : moins d’entraves, moins de contre-pouvoirs, moins de délibération, plus de décision, plus de verticalité. Et cette idéologie progresse partout, portée par une stratégie active et efficace de propagande, évidemment, toujours au nom de la liberté, de l’efficacité, évidemment.
On ne se trouve donc pas seulement face à une tentation autoritaire nourrie par la fatigue des sociétés. On est aussi face à une remise en cause active de la démocratie par des acteurs pour qui elle devient un paramètre à neutraliser plutôt qu’un principe à défendre.
Et c’est ce croisement-là, entre lassitude populaire et stratégie des élites, qui rend la séquence actuelle particulièrement instable.
Reste un point important.
Il me faut préciser que cette efficacité autoritaire repose sur une structure très particulière.
Cette efficacité, elle suppose la compression du désaccord, l’affaiblissement des contre-pouvoirs, une discipline forte des élites et un contrôle étroit des espaces de contestation. Les conflits ne sont pas réglés. Ils sont mis en sourdine. Quand le droit de manifester ou le droit de grève n’existe pas, évidemment, les trains roulent toujours. Le silence, ça fonctionne très bien pour produire de l’ordre.
Mais l’autoritarisme ne supprime pas les conflits. Il les rend invisibles.
Et tant que les élites restent cohésives, tant que la chaîne de commandement tient, tant que les résultats sont là, le système peut donner une impression d’efficacité redoutable.
À condition toutefois, et c’est un point de détail important, à condition d’accepter que certains paient pour les autres; que des droits, des libertés, parfois des vies, soient sacrifiés au nom du bien commun ou de la majorité. C’est une logique utilitariste assumée, une certains conception de la justice.
Et pour l’anecdote, on observe que presque toujours, quand on adhère à cette logique, on s’imagine spontanément du bon côté du sacrifice. L’expression “on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs” est rarement utilisée par les œufs qui vont être cassés. On s’imagine que ce sera l’autre qui devra se sacrifier pour le bien commun. C’est pratique.
Mais je m’égare
Un régime performant donc. Soit.
Mais cette performance est plus fragile qu’elle n’en a l’air.
Pourquoi ?
Parce que plus le pouvoir est concentré, plus l’erreur devient coûteuse à reconnaître, plus la correction devient difficile à opérer.
Les tensions qu’on empêche de s’exprimer ne disparaissent pas. Elles se déplacent, se rigidifient, s’accumulent hors champ, et finissent souvent par ressurgir de manière plus violente.
On peut le dire plus simplement : l’autoritarisme est efficace tant qu’il n’a pas besoin de se corriger.
La démocratie libérale repose sur une logique presque inverse, du moins dans son principe. Elle est lente, conflictuelle, souvent frustrante. Elle rend visibles les désaccords, expose les tensions, et paie un coût politique élevé pour chaque décision. Mais cette lenteur n’est pas un accident. Elle remplit une fonction précise : permettre la contestation, la correction, la révision des choix, le remplacement des dirigeants sans renverser tout l’édifice.
Le problème aujourd’hui n’est donc pas ce principe.
Le problème, ce sont les conditions très dégradées dans lesquelles il s’exerce, des conditions qui menacent clairement la démocratie.
Ce qui m’amène à ma dernière partie : comment une démocratie meurt ?
VII.Comment une démocratie bascule, en pratique ?
Quand on parle de bascule politique, on imagine un grand soir. Un coup d’État, des tanks, un palais, une nuit où tout bascule.
Or, ce qu’on observe le plus souvent aujourd’hui, c’est autre chose.
Une érosion. Un glissement progressif, légal, parfois même voté, qui finit par produire un régime différent sans avoir jamais annoncé qu’on changeait de régime. Et c’est précisément ce qui rend le phénomène difficile à regarder en face. Parce qu’il ne ressemble pas à une rupture, mais à une suite de “mesures raisonnables”.
Si je commence par là, c’est aussi parce que ce mouvement n’est pas une simple impression. À l’échelle mondiale, comme dit en introduction, on voit depuis une vingtaine d’années davantage de pays s’éloigner des standards démocratiques qu’y converger. Ce n’est pas partout, ce n’est pas uniforme, mais la tendance existe, et elle a un nom: le recul démocratique.
L’intérêt de le rappeler, ce n’est pas de jouer à se faire peur, c’est de comprendre la logique commune qui revient, avec des visages et des prétextes différents.
Le point de départ est presque toujours le même: une crise, ou plus souvent une accumulation de crises. Pas forcément la guerre. Ça peut être l’insécurité, le sentiment de déclassement, la fatigue économique, l’impression que les règles protègent mal, que l’État n’arrive plus à tenir ses promesses, que tout devient plus dur et plus confus.
Quelque chose change dans la tête d’une partie des gens. La question cesse d’être “est-ce conforme à nos principes ?”.
Elle devient “est-ce que ça marche ? Est-ce que ça protège ? Est-ce que ça tranche ?”.
C’est un basculement discret mais décisif, parce qu’il sépare, dans l’imaginaire collectif, la démocratie des droits. Les libertés deviennent des mots, des procédures, parfois même une forme de luxe moral réservé aux périodes calmes. Les garanties juridiques prennent l’allure d’un raffinement pour temps de paix.
Et quand on en arrive là, on peut faire accepter beaucoup de choses sans jamais dire “je veux effacer l’état de droit”. Il suffit de répéter autre chose: justice, efficacité, bon sens, ordre, protection. Le vocabulaire change, et avec lui, la hiérarchie des priorités.
C’est souvent à ce moment-là qu’entre en scène un récit très puissant, parce qu’il est simple et profondément humain: le récit du sauveur.
Un leader, un camp, une coalition promet de faire ce que “le système” n’arrive plus à faire. Pas en parlant de dictature, évidemment. Les mots font peur.
On parle de remettre de l’ordre, de “simplifier”, de “reprendre le contrôle”, de faire tomber les blocages.
Et comme tout récit de sauvetage a besoin d’une menace, il lui faut un ennemi.
Les juges, les médias, les bureaucrates, “les élites”, “l’État profond”, les étrangers, les communistes, les khmers verts, les wokes, les assistés, peu importe le casting, la structure est stable: il faut un responsable identifiable, généralement qui se trouve à l’intérieur de la société, quelque chose ou quelqu’un qui empêcherait le pays d’aller mieux.
Et plus l’ennemi est vague, plus il est utile, parce qu’il peut changer de forme selon les besoins du moment, et justifier des pouvoirs eux-mêmes vagues, extensibles, difficiles à contester. On ne combat pas un virus avec des règles, on combat un virus avec des “mesures d’urgence”. Et l’urgence, par définition, aime les raccourcis.
Ensuite, le mécanisme est presque toujours le même.
On ne commence pas par supprimer les élections. On commence par affaiblir tout ce qui donne un sens réel à l’élection.
On fragilise l’information partagée. On sape la confiance dans les médias, dans la recherche, dans les institutions d’expertise. On transforme l’idée même de vérité en opinion parmi d’autres, avec une conséquence pratique très simple: si rien n’est certain, alors tout devient affaire d’allégeance.
On se met à choisir un camp, puis à choisir les faits qui vont avec. Et quand la réalité commune se délite, la démocratie devient mécaniquement plus fragile, parce qu’elle suppose, au minimum, un terrain de discussion partagé.
Dans le même temps, on s’attaque aux contre-pouvoirs quand ils deviennent gênants.
On parle rarement d’attaquer la justice. On parle de la “réformer”. De la rendre plus rapide. De lutter contre son supposé laxisme. On parle de protéger les honnêtes gens. On parle de mettre fin à l’impunité. Et si ça ne va assez vite ou dans la direction qu’on souhaite, on remet en question la légitimité des juges ou de leurs décisions. Après tout un juge ne peut-il pas être lui aussi un ennemi de l’intérieur.
Là encore, l’objectif immédiat semble défendable, et c’est ce qui rend le processus efficace.
Puis viennent des mesures techniques: nominations, réorganisations, nouvelles règles disciplinaires, budgets, procédures. Ça ne ressemble pas à une confiscation du pouvoir. Ça ressemble à de la gestion. Jusqu’au jour où l’on découvre que l’institution qui devait dire “non” ne peut plus vraiment le dire.
Et il y a un point important, souvent invisible au début: l’érosion commence presque toujours par les marges. Par ceux dont les droits préoccupent peu la majorité. Les suspects. Les délinquants. Les prisonniers. Les étrangers. Les minorités déjà peu aimées.
C’est là que l’on teste des durcissements, des procédures expéditives, des extensions de pouvoirs policiers, des restrictions de manifestation, des exceptions qui deviennent des habitudes ou même des décision ou des actes illégaux.
Parce que c’est plus facile à vendre, et parce que beaucoup se disent: “ça ne me concerne pas”.
Sauf qu’un système politique apprend vite. Une fois que l’exception est entrée dans le paysage, elle devient un outil disponible, et l’échelle d’application s’élargit presque toujours. Aujourd’hui sur eux, demain sur d’autres, après-demain sur tout le monde, quand la catégorie “eux” se met à s’étendre.
Puis arrive la phase la plus dangereuse, justement parce qu’elle est banale: l’habituation.
On s’habitue à l’idée que certaines règles sont secondaires.On s’habitue à ce que certains droits deviennent conditionnels. On s’habitue à ce que l’opposition soit décrite non comme un adversaire, mais comme un danger. On s’habitue à l’idée que la démocratie était déjà abîmée, donc qu’on ne perd pas grand-chose.
Et au bout du processus, paradoxe total, on continue souvent à voter. Simplement, on vote dans un système où l’alternance devient plus difficile, plus coûteuse, plus risquée, parfois même impraticable. Le décor reste, la logique a changé.
Ce que l’histoire nous apprend, et ce que l’actualité confirme, c’est que la démocratie ne meurt presque jamais en annonçant sa mort. Elle se transforme. Elle s’évide. Et quand on s’en rend compte, on découvre souvent que le plus dur n’est pas de voter, c’est de retrouver les conditions qui font que voter signifie encore quelque chose.
Quand on se rend compte que la démocratie est morte, c’est trop tard.
Conclusion – Gouverner dans un monde qui a changé
Ce que l'écriture de cet épisode m'a laissé comme impression, c'est celle d'une tension difficile à tenir. Celle entre la lucidité sur ce qui dysfonctionne et le refus de céder à la tentation autoritaire.
Je comprends très bien pourquoi l'argument "attention, la démocratie est en danger" ne convainc plus grand monde. Quand on a le sentiment que la dégradation est déjà là, que le système est pourri de l'intérieur, la tentation est grande de tout envoyer balader. Ou au moins d'accepter qu'on mette certains principes de côté, temporairement, le temps de remettre de l'ordre.
Et franchement, il est difficile d'accorder du crédit aux dirigeants en place. Entre les fichiers Epstein qui montrent à quel point des figures puissantes – politiques, économiques, médiatiques – sont compromises sans qu'il ne leur arrive rien, la médiocrité visible d'une partie de la classe politique, et la facilité avec laquelle certains passent du service public aux intérêts privés ou étrangers après leur mandat, il y a de quoi perdre confiance. Cette défiance n'est pas irrationnelle. Elle s'ancre dans des faits, dans des silences, dans l'écart persistant entre ce qui est dénoncé et ce qui est réellement sanctionné.
Mais je me méfie profondément du discours anti-élites généralisé. Parce qu'il est presque toujours récupéré par d'autres dominants, prêts à surfer sur la colère pour prendre la place des précédents. Pas pour relever le niveau, mais pour concentrer le pouvoir à leur profit. Trump a prospéré sur ce registre, en dénonçant ceux qui n'osaient pas sortir les dossiers Epstein, tout en étant lui-même largement présent dans ces mêmes dossiers. Chez nous, ceux qui réclament une justice plus dure sont souvent les premiers à contester les verdicts lorsqu'ils les concernent. C'est une farce tragique. Et une mécanique redoutablement efficace.
Tout cela rend la foi démocratique difficile. Pas au sens moral, mais au sens politique : croire que le système peut encore produire autre chose que de la médiocrité, de l'hypocrisie ou de l'impunité.
Pourtant, avertir contre la tentation autoritaire ne suffit pas tant que la démocratie ne propose rien d'autre qu'un statu quo dégradé. Si elle veut rester crédible, elle doit démontrer qu'elle peut produire plus de sécurité, plus d'efficacité, plus de justice. Qu'elle peut arbitrer mieux le long terme et le court terme, protéger les plus vulnérables, développer et garder les talents, préserver la liberté, sans briser l'État de droit.
Et ça suppose aussi de se regarder dans un miroir. Nos marges de manœuvre individuelles sont limitées, nous dépendons d'un système. Mais quand même. Avons-nous, collectivement, le niveau de connaissance, d'attention, d'exigence, de cohérence nécessaire pour faire fonctionner un pays démocratique dans un monde contraint ? Soutient-on vraiment la démocratie quand on achète du fast fashion made in Ouïghours, quand on délègue notre attention à des plateformes qui n'ont aucun intérêt démocratique, quand on alimente des écosystèmes économiques qui contournent les règles communes ? Je suis moi-même empêtré dans ces contradictions, comme beaucoup d'entre vous. Mais ces questions restent posées.
Ce qui m'inquiète le plus, c'est que la démocratie est probablement entrée, depuis longtemps déjà, dans une phase de dysfonctionnement structurel. Entre la construction européenne devenue illisible, le déplacement du pouvoir réel vers la finance et la tech, l'internationalisation des élites, la fragmentation informationnelle, les tensions identitaires, et les contraintes énergétiques et climatiques qui se referment, le cadre dans lequel la démocratie libérale s'est stabilisée au XXᵉ siècle n'existe plus vraiment.
C'est aussi à ça que sert la compréhension des cycles. Pas à prédire l'avenir, mais à accepter que nous n'avons pas totalement la main. Que certaines dynamiques dépassent les intentions, les discours, les programmes.
Vu sous cet angle, la question n'est peut-être plus tellement de savoir comment sauver la démocratie telle qu'on l'a connue. Pour être clair : je pense que le projet démocratique reste pertinent, malgré ses imperfections. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est surtout de savoir comment atterrir. Comment traverser une phase de durcissement devenue largement inévitable, sans se tromper sur le profil de ceux à qui l'on confie les commandes ?
Comment distinguer ceux qui sont capables de réformer en profondeur, de remettre de la cohérence, de changer les règles quand il le faut, sans rendre toute correction ultérieure impossible ? À partir du moment où on décide de mettre en place une surveillance généralisée au nom de la sécurité, où on affaiblit les contre-pouvoirs au nom de la vitesse, on prend un risque énorme pour la suite. Le retour en arrière devient presque impossible.
Franchement, je ne sais pas comment sortir par le haut de ces impasses. Mais je sais à qui je n'ai pas envie de faire confiance pour y réfléchir.
Voilà. Comme toujours, mon but n'est pas de trouver une solution. J'ai surtout cherché à mieux comprendre ce moment, pour ne pas y réagir uniquement à l'émotion, à la fatigue ou au ressentiment. Tant qu'il nous reste un peu de voix, un peu de marge, un peu de temps, ce travail de lucidité me semble indispensable.
Merci pour votre attention. J'ai passé pas mal d'heures à travailler sur cet épisode et j'espère qu'il vous aura apporté quelque chose. Encore une fois, je n'ai pas fait le tour d'un sujet aussi large et pardonnez-moi si selon vous il manque des points clés. Merci pour votre soutien si vous faites partie des heureux donateurs et donatrices, vous êtes mon rayon de soleil et grâce à vous je peux soutenir mon boulanger, mon banquier et mon propriétaire à mon tour. Vous pouvez retrouver la transcription complète sur sismique.fr, les références, des suggestions de lecture et plein de contenus pour aller plus loin.
Et je vous laisse avec quelques citations en lien avec notre petit sujet du jour :
D’abord pour penser contre soi-même :
« La tyrannie naît d'un excès de liberté, lorsque le désir d'être libre de toute contrainte se retourne en son contraire et appelle un maître fort. » – Platon
« La démocratie est une croyance pathétique en la sagesse collective de l'ignorance individuelle. » – H. L. Mencken
« Le meilleur argument contre la démocratie est un entretien de cinq minutes avec un électeur moyen. » – Winston Churchill
« Chaque fois que vous avez un gouvernement efficace, c'est une dictature. » – Harry Truman
Et un peu plus positif :
« La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. » – Albert Camus
« La capacité de l'homme à faire preuve de justice rend la démocratie possible, mais son penchant pour l'injustice rend la démocratie nécessaire. » – Reinhold Niebuhr
« La démocratie est la pire forme de gouvernement à l'exception de toutes les autres qui ont été essayées au fil du temps. » – Winston Churchill
À bientôt.
Soutenez Sismique
Sismique existe grâce à ses donateurs. Aidez-moi à poursuivre cette enquête en toute indépendance.
Merci pour votre générosité ❤️
Suggestion d'autres épisodes à écouter :
STEVE BANNON : Le plan du stratège du populisme mondial
Au cœur de la vision illibérale qui redessine le monde occidental
Le retour du fascisme ? Décrypter les nouveaux autoritarismes
De Mussolini aux algorithmes, comment le fascisme se réinvente et comment empêcher son retour ? Nommer le fascisme aujourd’hui pour ne pas répéter les erreurs d’hier
Souveraineté : l’Europe à genoux ?
Défense, énergie, technologie, économie… Les dangers de nos dépendances.
La Chine et le monde : décryptage
Vision du monde, pouvoir, guerre commerciale : décryptage de la Chine par André Chieng
État de droit : comment les démocraties déraillent
Populisme, justice, démocratie : décryptage des glissements vers l’autoritarisme
Droit international : la fin d’une hypocrisie ?
Israël, USA, Iran, Gaza… Quand seule la force fait loi : le droit international est mort.
Opération Venezuela : le retour des empires
Opération Absolute Resolve, Trump et la fin de l’ordre libéral. Comprendre la nouvelle grammaire de la puissance à la suite de l'opération "Résolution absolue".
Peter Thiel, maître du jeu
Peter Thiel a un plan. Les démocraties en danger.... Suite de l'analyse de la révolution trumpienne en cours et de ses coulisses
Comprendre les électeurs d’extrême droite
Enquête sur la normalisation de l’extrême droite avec l’auteur du livre Des électeurs ordinaires
Le monde d'hier. Un regard sur notre époque - Stefan Zweig
L’histoire se répète-t-elle ? Réflexion sur Le Monde d’Hier, livre testament de Stefan Zweig