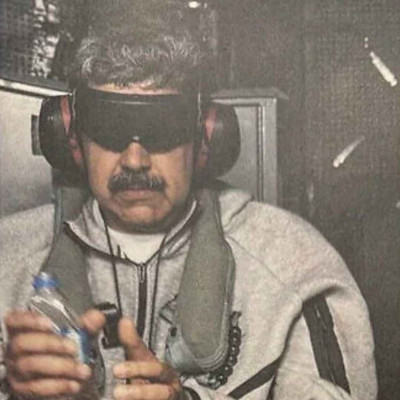Pourquoi une scène ultra-violente dans une série nous atteint moins qu’avant ? Pourquoi faut-il aujourd’hui plus d’intensité, plus de choc, pour ressentir quelque chose ?
Dans cet épisode, on part d’un simple décalage vécu devant un écran pour remonter un fil beaucoup plus large : un siècle de fiction, l’économie de l’attention, l’explosion des images réelles filmées au téléphone, et notre système nerveux qui s’habitue sans nous prévenir.
On explore ce que la psychologie sait de la désensibilisation, ce que la sociologie dit de la disparition des médiations collectives, et ce que tout cela change dans notre rapport au tragique, aux autres, et au monde qui nous entoure.
Un épisode pour comprendre comment notre seuil sensible se déplace, et comment continuer à regarder sans s’éteindre.
Je regarde une série, un soir, sans intention particulière, comme on est beaucoup désormais à le faire.
Une journée fatigante, l’esprit un peu en vrac, l’envie de se poser sans réfléchir. C’est devenu un geste automatique : on allume, on se laisse porter. Rien d’exceptionnel donc.
Et puis une scène arrive.
Une scène violente, mais pas comme on les voyait autrefois, maladroites, suggérées, masquées par la technique. Non : tout est net. Précis. Chorégraphié. Le corps d’un personnage explose littéralement, filmé au ralenti, avec une précision presque clinique.
Une musique légère vient se poser par-dessus, la bande-son guide notre réaction, l’encadrer, lui donner une couleur. De l’ultra-violence certes, mais sur un bon son entrainant. Normal quoi.
Je regarde tout ça, et je remarque un décalage en moi.
Une part de moi réagit encore. Une crispation, une gêne. Un rappel que cette image, même fictive, touche un endroit sensible.
Et en même temps, je sens que quelque chose d’autre s’est émoussé. Comme si je n’étais plus atteint de la même manière qu’avant. Comme si le choc avait glissé, amorti par des années d’images de plus en plus extrêmes.
Ce moment m’a laissé un arrière-goût étrange.
Pas à cause de la scène elle-même, mais parce que j’ai senti que mon regard avait changé, presque sans que je m’en rende compte. Une sorte de fatigue morale, un recul de la sensibilité, quelque chose de discret mais réel. Et je me suis demandé d’où ça venait.
Comment on en est arrivés là. Et pourquoi cette violence, qui aurait été insoutenable il y a vingt ou trente ans, passe aujourd’hui comme un élément banal du divertissement.
Alors j’ai voulu creuser. Pas pour faire un procès au cinéma ou aux séries. Pas pour jouer les alarmistes. Mais pour comprendre ce glissement, cette saturation d’images extrêmes qui entourent désormais nos vies, et ce que cela produit en nous, individuellement et collectivement.
Comment la violence est devenue si présente dans notre culture visuelle.
Comment elle s’est transformée.
Et comment, parfois, elle s’invite même dans notre quotidien sous des formes beaucoup plus réelles et beaucoup plus troublantes.
C’est un épisode un peu atypique, peut-être pas un sujet de préoccupation majeur, mais c’est un sujet qui me préoccupe depuis un moment.
C’est une exploration de notre rapport aux images mais aussi de notre sensibilité, de la manière dont elle évolue, dont elle se défend, dont elle se fatigue peut-être aussi.
Et de ce que tout ça raconte sur le monde dans lequel on vit et de notre capacité à le regarder sans être anhéstésié.
Je me suis dit qu’il y avait un truc intéressant à creuser là. On va voir…
Extrait TBD
COMMENT LA VIOLENCE A CHANGÉ DE VISAGE ?
On va commencer par une brève analyse de la progression de la violence dans le cinéma.
Un premier tournant majeur arrive au début des années 70, avec Orange mécanique de Kubrick.
Le film choque profondément, non seulement parce qu’il montre des agressions frontales, mais surtout parce qu’il les met en scène comme une sorte de ballet. Violence stylisée, musique classique, chorégraphie.
Le scandale est immense, plusieurs pays l’interdisent, et un débat massif s’ouvre sur l’effet des images violentes.
Avec le recul, on réalise que cette brèche ne va plus jamais se refermer.
Parce que quand on regarde l’évolution de la culture visuelle sur un demi-siècle, on voit un glissement lent, continu, presque mécanique, et on peut suivre ce glissement assez nettement.
Dans les années 80, un film comme RoboCop surprend par son niveau de brutalité pour un grand public. La scène où Murphy se fait démembrer choque profondément. On débat. On s’interroge sur la limite. C’est un premier signal : on peut aller plus loin.
https://www.youtube.com/watch?v=aut8JO_wCE0
Les années 90 amplifient ce mouvement, notamment avec Tarantino.
Reservoir Dogs pose cette fameuse scène de l’oreille coupée, alors que le bourreau danse sur une musique folk.
Deux ans plus tard, Pulp Fiction, Palme d’or à Cannes, installe cette distance ironique : la violence n’est plus l’objet central, elle circule simplement dans le récit, presque familière, parfois absurde, voire drôle. La stylisation devient une manière d’apprivoiser le choc. Le public suit. https://www.youtube.com/watch?v=YydcqJVnd-U
Puis une autre forme apparaît.
Avec Natural Born Killers, Tueurs nés, suit un couple de psychopates. La violence est permanente, gratuite. Oliver Stone montre la violence comme un produit médiatique. Le scandale tient moins à ce qu’on voit qu’à ce qu’il dit : la représentation du meurtre peut devenir un spectacle social. https://www.youtube.com/watch?v=hoApQyIFouU
Et puis il y a cette scène de meurtre dans American History X d’une violence inédite qui en a traumatisé plus d’un.
Le début des années 2000 pousse un cran plus loin encore.
La vague Saw, Hostel, “torture porn” met la souffrance au centre. On n’est plus dans le suggéré, plus dans l’ellipse : on expose, on montre, longuement. La violence n’est plus un moment, elle devient la structure. https://www.youtube.com/watch?v=5jUiu8vCNDk
En parallèle, un autre registre s’installe.
Des films comme Kick-Ass, Deadpool, et plus tard Kingsman jouent avec l’excès comme on joue avec un ressort comique. La scène de l’église dans Kingsman — un massacre filmé comme un clip musical — résume parfaitement cette étape : l’extrême devient un geste esthétique. On ne cherche pas à choquer, mais à surprendre, à divertir.
Les séries prennent ensuite le relais et approfondissent cette logique. https://www.youtube.com/watch?v=9VjMaJmbcfMhttps://www.youtube.com/watch?v=90OFZQx_7xI
Game of Thrones installe la violence dans la durée, dans la familiarité. Décapitations, viols, tortures : rien n’est jamais épargné, et c’est l’ensemble de l’univers narratif qui devient violent. La violence n’est plus un événement, elle est un climat. https://www.youtube.com/watch?v=qS1Fswg6p5A
Plus tard, The Boys pousse cette mécanique jusqu’au grotesque. On explose des corps comme on casserait des bonbons. L’excès devient un miroir : si ça fonctionne comme divertissement, c’est que notre seuil a déjà changé. https://www.youtube.com/watch?v=cJukUFVNd38
À partir de là, un autre tournant s’opère avec Squid Game. (https://www.youtube.com/watch?v=J7FqiKJmwEI)
La série mélange l’esthétique enfantine et la mise à mort. Les couleurs pastels, les musiques rassurantes, les formes géométriques… tout contraste avec la cruauté du jeu. Et ce contraste circule massivement sur TikTok : découpé en fragments, imité, rejoué, transformé en défi. La violence devient une mécanique ludique, détachée du contexte moral qui l’entourait.
En parallèle, un phénomène économique s’impose : l’horreur devient l’un des genres les plus rentables de l’industrie.
En dix ans, sa part au box-office a doublé. Elle représente aujourd’hui près de 10 % des entrées en Amérique du Nord. Parce qu’un film d’horreur coûte peu et rapporte parfois dix, vingt, cent fois son budget. Dans un Hollywood obsédé par le risque, c’est devenu une anomalie économique : un genre où la rentabilité est presque garantie. https://www.youtube.com/watch?v=5jUiu8vCNDk
https://www.youtube.com/watch?v=vVO7gpdA5P4
La conséquence est mécanique : plus on en produit, plus il faut se distinguer ; plus il faut se distinguer, plus on cherche des idées “fortes”, des images inédites, des mises en scène toujours plus marquées.
Enfin, un autre terrain modifie en profondeur notre rapport à la violence : le jeu vidéo.
Avec Doom, puis GTA, puis les FPS compétitifs modernes comme l’incontournable Fortnite, un glissement apparaît : la violence n’est plus regardée, elle est exécutée. Non pas pour être crue, mais parce que c’est la mécanique du jeu. Traquer, Viser, Tirer, répéter. Non pas comme un acte moral, mais comme un geste fonctionnel.
https://www.youtube.com/watch?v=MnqLJpgq7jchttps://www.youtube.com/watch?v=zjMkNJswEdAhttps://www.youtube.com/watch?v=eqiKA4lt4Mc
Pas de diabolisation ici : simplement le constat qu’on ajoute une couche interactive à un paysage visuel déjà chargé.
Mis bout à bout, tout cela raconte un mouvement assez simple : la violence n’a pas envahi nos récits d’un coup. Elle s’est transformée, stylisée, intégrée, parfois retournée en comique, parfois en satire, parfois en simple motif visuel.
Elle est passée du statut d’événement exceptionnel à celui de matière ordinaire dans un paysage saturé d’images.
Alors, si j’ai mis quelques extraits de fiction dans cet épisode, c’est pour poser indirectement une question simple : où en est votre sensibilité ?
Si ces son et ces images ne vous font plus rien du tout, alors oui, il y a peut-être un sujet.
Ok, donc, plus de violence.
Pour résumer, je vous lis ce passage de la chanson Petit Frère d’IAM issue de l’album l’école du micro d’argent (un des albums que j’ai le plus écouté), qui résumait je crois pas mal les choses dès 1997 .
Les journalistes font des modes, la violence à l'école existait déjà
De mon temps, les rackets, les bastons, les dégâts
Les coups de batte dans les pare-brise des tires des instituteurs
Embrouilles à coups de cutter
Mais en parler au journal tous les soirs ça devient banal
Ça s'imprime dans la rétine comme situation normale
Et si petit frère veut faire parler de lui
Il réitère ce qu'il a vu avant huit heures et demie.
Et voici donc question clés, histoire reboucler avec les problématiques classique de ce podcast.
Qu’est-ce que ce spectacle de la violence dit de la société ?
Qu’est-ce que ça fait à la société ?
Et qu’est-ce que ça nous fait à nous, à nos corps et à nos esprits ?
CE QUE CES IMAGES FONT AU CORPS ET AU CERVEAU
Quand on se demande ce que ces images nous font, il faut quitter un instant les écrans et regarder du côté du corps.
J’ai ptassé quelques études, histoire de ne pas raconter complètemet n’importe quoi, notamment celles menées par Barbara Krahé (prof de psychologie social de l’université de Postdam) et son équipe sur la dessensibilisation à la violence médiatique (Desensitization to Media Violence).
Ce que Barbara démontre est très simple et très cohérent avec ce que n’importe qui peut ressentir intuitivement : le système nerveux apprend.
Quand on est exposé à une scène violente, même complètement fictive, le corps réagit : le cœur accélère un peu, la peau réagit, la respiration change. C’est une vieille mécanique.
Mais dans les expériences menées par Krahé et d’autres chercheurs, on observe que plus les participants ont été exposés à la violence dans les médias au cours de leur vie, plus ces réactions physiologiques sont faibles.
Pas nulles, juste plus basses.
Comme si le système nerveux recalait son seuil d’alerte.
On retrouve la même logique dans les travaux rassemblés dans l’étude de Anderson & BushmanMedia Violence and the General Aggression Model.
Le GAM, modèle d’agression général est un modèle théorique, mais il reste très ancré dans des mécanismes concrets : il décrit comment le cerveau encode, au fil du temps, des “scripts” d’interprétation.
Autrement dit, il apprend à reconnaître plus vite certains schémas d’action, des gestes, des attitudes, des enjeux, parce qu’il les a vus souvent.
Là encore, il ne s’agit pas de dire que regarder un film violent change quelqu’un immédiatement.
Les études ne disent pas ça.
Elles montrent plutôt comment un certain type d’exposition façonne la manière dont le cerveau traite les situations ce qu’il repère en premier, ce qui lui semble familier, ce qu’il ne remarque plus.
Dans plusieurs travaux longitudinaux, on observe aussi un changement du côté de l’empathie, mais de manière assez subtile.
Quand les signaux de détresse, une grimace, un cri, un geste de douleur, apparaissent dans un contexte où la violence est très présente visuellement, ils sont traités plus lentement.
Non par froideur ou par cynisme, mais parce que le cerveau les classe différemment : ils deviennent moins saillants, moins urgents, moins exceptionnels.
Beaucoup d’études convergent vers cette idée d’un glissement du seuil sensible.
C’est jamais un renversement brutal mais plutot un empilement de micro-expériences : un extrait violent sur une plateforme, une bagarre dans une série, une vidéo filmée au téléphone qui circule sur TikTok, un moment intense dans un jeu vidéo.
Aucune de ces images, prise isolément, ne transforme quelqu’un.
Mais leur accumulation modifie la manière dont le système nerveux filtre, hiérarchise, réagit.
Donc ce décalage que j’ai ressenti l’autre soir devant ma série s’explique très simplement : quand un certain type d’image revient souvent, le corps ajuste ses seuils. Une scène objectivement violente déclenche une réaction un peu plus faible, non par indifférence, mais par habitude.
Ce mécanisme est connu.
Ce qui m’intéresse, c’est ce qu’il devient dans l’environnement actuel.
Qu’est-ce que ce mouvement d’habituation produit quand les images ne sont plus filtrées, mises en scène ou contextualisées, mais brutes, immédiates, tirées du réel ?
Les chercheurs parlent parfois de trauma vicariant pour décrire cette forme d’usure émotionnelle liée à la répétition de scènes de détresse qu’on ne vit pas soi-même.
À l’échelle d’une société entière, certains utilisent l’expression de trauma culturel pour désigner ce glissement collectif quand les repères émotionnels s’érodent sous l’effet de l’accumulation.
Pas besoin d’en faire une pathologie.
C’est plutôt une sensibilité qui change, un climat intérieur qui se déplace.
Un autre point à ce ne sont plus les films ou la télévision qui façonnent l’essentiel des sensibilités surtout chez les plus jeunes mais les plateformes. Et ce n’est plus le même cadre. Ni les mêmes limites.
C’est ce territoire-là que je vous propose d’explorer maintenant.
TRANSITION ?
LE RÉEL DANS LE FLUX
La violence ne vient plus seulement des films, des séries ou des jeux.
Elle arrive désormais du monde réel : captée par un téléphone, mise en ligne, partagée, rejouée,
absorbée dans le flux quotidien des plateformes.
Pendant longtemps, ces images circulaient dans des endroits un peu en marge.
Des plateformes que beaucoup ne connaissaient même pas : Ogrish, LiveLeak, BestGore.
Elles ont existé presque dans l’ombre, comme des zones grises d’internet où l’on pouvait trouver des vidéos d’accidents, d’agressions, de guerres, de cartels, de lynchages, d’exécutions.
Leur existence n’était pas totalement secrète, mais elle était feutrée, il fallait chercher.
Un espace parallèle, un peu interdit, un peu fascinant, vers lequel beaucoup d’adolescents ont fini par tomber par curiosité ou par défi.
Ce qui frappait, ce n’était pas seulement ce qu’on voyait, mais la manière dont on le voyait : brut, sans montage, sans mise en scène, sans distance esthétique.
Des images directes. Des corps réels. Des cris réels. Une temporalité réelle. Aucune fiction pour atténuer.
Ces plateformes ont été heureusement fermé ou ont été marginalisées, mais l’esprit de ces images s’est répandu ailleurs.
Aujourd’hui, ce n’est plus LiveLeak qui diffuse ces scènes :
ce sont TikTok, Twitter (X), Telegram, Discord, Snapchat.
Des espaces où le public est plus jeune, plus vaste, plus mélangé.
Et surtout : des espaces où la violence apparaît mélangée à tout le reste.
C’est ça, le glissement le plus profond.
Les images violentes ne sont plus contenues dans des zones séparées.
Elles surgissent au milieu d’autres contenus : un tutoriel cuisine, un mème, une danse, puis soudain une vidéo d’agression filmée dans la rue, un règlement de compte de cartel mexicain, une execution de Daesh, un extrait de guerre.
On peut passer de l’un à l’autre en quelques secondes, sans transition, sans préavis. Les images n’arrivent plus entourées d’avertissements, de cadres, de discussions. Pas de contextualisation.
Pour les plus jeunes, ce mélange crée une relation particulière à ces images.
Elles ne s’imposent pas par leur gravité : elles s’insèrent dans le même flux que le reste, elles apparaissent comme un fragment parmi d’autres, sur le même écran.
Et c’est précisément ce qui les rend difficiles à interpréter.
Beaucoup d’adolescents parlent d’ailleurs de ces vidéos comme d’un test de résistance, un jeu.
Ils les regardent par défi, pour montrer qu’ils ne sont pas facilement impressionnés.
J’ai vu passer des témoignages de jeunes qui expliquent que, dans certains groupes Discord, regarder une vidéo de cartels était une façon de “faire partie du groupe”.
Une sorte de rite d’entrée. Une preuve qu’on ne flanche pas.
Ce n’est pas tout à fait nouveau : dans toutes les cultures, les adolescents testent les limites, cherchent à éprouver leur courage, se confrontent à des images interdites.
Mais émotionnellement, ce n’est pas neutre.
Une fois de plus c’est ce que nous disent les études déjà évoqués : l’exposition répétée à la violence affaiblit la réaction du corps, que ces images soient fictives ou réelles.
Et le fait est qu’aujourd’hui la frontière entre fiction et réalité est devenue floue, elle n’a plus le même rôle protecteur.
Elle n’aide plus aussi clairement le corps à se préparer, à se mettre à distance, à se mobiliser.
Ce brouillage ne dit rien sur “la jeunesse” ou “la moralité”. Il dit quelque chose sur notre époque où le monde réel est devenu un spectacle.
Ce brouillage ouvre la porte à la question suivante :
qu’est-ce que cette exposition change dans la manière dont une société perçoit la violence ?
Non seulement individuellement, mais collectivement ?
La sociologie et la philosophie nous donnent des clés de compréhension. J’en explore quelques-unes.
CE QUE LA SOCIOLOGIE ET LA PHILOSOPHIE NOUS DISENT DE CE RETOUR DU SANGLANT
Les sociologues et les philosophes nous disent depuis longtemps que la manière dont une société regarde la violence est un indicateur profond de son organisation.
Et ce qu’on observe aujourd’hui, c’est un déplacement qui touche trois niveaux : le corps, la forme, et les cadres symboliques.
1. Le corps et la sensibilité : un seuil qui s’ajuste
Pendant des siècles, les sociétés occidentales ont travaillé à éloigner la violence du regard.
Norbert Elias décrit ce long mouvement : la disparition des supplices publics, la honte associée aux gestes brutaux, la mise à distance du sang.
Michel Foucault, de son côté, montre comment l’État moderne a retiré la souffrance du champ public pour exercer la force de manière plus discrète, plus contrôlée, moins risquée politiquement.
Deux angles différents, une même tendance : notre seuil sensible a été façonné par une culture où le corps souffrant devenait rare, presque tabou.
Les recherches psychologiques que j’ai évoquées plus tôt prolongent cette idée.
Elles montrent que notre système nerveux s’ajuste en fonction de ce qu’il voit souvent.
Il enregistre, classe, s’habitue.
Le corps modifie ses seuils d’alerte pour s’adapter au paysage visuel.
Et à ce rythme-là, oui : notre génération réagit moins fortement que celle de nos grands-parents.
Il faut désormais beaucoup d’intensité pour nous choquer vraiment.
2. La forme des images : une époque où le tragique se dissout
Deuxième mouvement : la transformation de la forme.
Guy Debord parlait d’une société où tout passe par la mise en scène où tout est spectacle.
Neil Postman expliquait que le divertissement devient la forme dominante, presque par défaut.
Non pas par légèreté, mais parce que les systèmes médiatiques privilégient ce qui circule vite, ce qui retient immédiatement.
Dans cette logique, une image dramatique n’est plus un événement mais un simple extrait, un format, parfois même un gimmick, un meme. L’important c’est qu’on visionne, rien d’autre.
Hannah Arendt évoquait la “fatigue du jugement” : quand les événements graves s’enchaînent trop vite, la pensée n’a plus le temps de s’installer.
Le flux permanent accélère encore ce phénomène. Le tragique n’a pas disparu mais il n’a simplement plus le temps de devenir signifiant.
3. Les cadres symboliques : une société qui montre tout mais absorbe de moins en moins
Troisième mouvement, le plus profond : la disparition des médiations.
René Girard disait qu’une société ne peut supporter la violence que si elle la transforme, par des récits, des rituels, des discussions collectives, des institutions capables de donner forme à ce qui, autrement, serait insoutenable. https://www.youtube.com/watch?v=U9G_IdEdMvc&t
Or le numérique renverse cette architecture.
Il ramène dans le regard des scènes que les sociétés avaient méthodiquement mises à distance, mais sans leur redonner le cadre symbolique qui permettait de les absorber.
Les images violentes apparaissent isolées, brutes, dans des espaces privés où elles ne sont ni accompagnées, ni discutées, ni intégrées dans un récit commun.
Et souvent, il n’existe plus d’endroit où en parler : ni dans les familles, ni dans les écoles, ni dans les espaces publics qui permettaient autrefois de traiter la violence collectivement.
Le problème n’est donc pas tant que ces images existent, mais qu’elles circulent sans lieu où être travaillées, interprétées, digérées. Ça donne une société qui ne traite plus ses névroses. Chacun se débrouille comme il peut.
Je voudrais tout de même m’attarder sur le moteur de tout ça, la logique qui sous-tend la diffusion de ces contenus. Comme presque toujours, follow the money : suivez l’argent
L’ÉCONOMIE DU CHOC
Il faut bien comprendre une chose : l’attention est devenue la ressource essentielle de l’économie médiatique. Parce que l’attention, c’est de la data, c’est de la pub vendue, des abonnements, des tickets, et donc c’est de l’argent. C’est sur ça que repose internet, les jeux vidéos, la télé, le cinéma. Et dans un système organisé autour de ce principe, tout ce qui accroche le regard gagne instantanément en valeur.
La violence fait partie de ces signaux auxquels le cerveau réagit immédiatement, comme un écho lointain de réflexes anciens liés au danger. Un mouvement brusque, un cri, une menace perçue dans un coin du champ visuel, et le système d’alerte interne se met en route avant même qu’on ait compris ce qu’on regarde.
Ce n’est pas de l’attirance au sens moral du terme. C’est un vieux mécanisme de survie qui nous pousse, instinctivement, à fixer ce qui pourrait représenter un risque.
Les plateformes, les producteurs de contenu n’ont pas cherché à encourager cette esthétique, elles ont simplement constaté qu’elle retenait davantage. Et dès qu’un type d’image fonctionne, l’algorithme en augmente la visibilité. C’est la dynamique de ces environnements : ce qui capte se propage.
Tout le reste découle de cette logique. Dans un environnement informationnel surchargé, chaque contenu doit trouver un moyen d’émerger. Les films, les séries, les vidéos courtes ajustent donc leur langage : scènes plus rapides, rythmes plus tendus, intensité plus frontale, moments marquants placés plus tôt dans le récit. Le spectaculaire devient une façon de ne pas disparaître dans la masse.
L’horreur illustre bien ce phénomène. C’est aujourd’hui l’un des genres les plus rentables : des budgets faibles, des retours parfois énormes, une prise de risque limitée. Dans une industrie où chaque échec peut coûter des dizaines de millions, ce positionnement attire. On en produit davantage, ce qui entraîne une course à l’originalité, puis une escalade dans les images.
Dans cet écosystème où tout cherche à occuper une place dans l’esprit du spectateur, la violence devient un motif visuel reconnaissable. Un langage commun, utilisé pour attirer l’attention dans un environnement saturé.
Ce processus ne résulte d’aucune intention centralisée. C’est une dynamique d’imitation et d’ajustement permanent : studios, créateurs, plateformes observent ce qui retient, s’adaptent, renforcent les tendances visibles. Peu à peu, la surenchère s’installe par simple nécessité de survivre dans la compétition.
Pour le public, cela crée un paysage où les images violentes deviennent courantes. Et ce glissement transforme silencieusement notre manière de réagir à ce qui nous entoure, et altère notre perception de la gravité.
CE QUE CELA DÉPLACE À L’ÉCHELLE DE LA SOCIÉTÉ
Après tout ce qu’on vient de parcourir, une chose est claire : les images violentes ne sont pas seulement un phénomène culturel ou économique.
Petite parenthèse nécessaire : les sociétés humaines sont globalement moins violentes qu’avant.
Les homicides ont reculé sur plusieurs siècles, les guerres entre États sont plus rares, la brutalité institutionnelle n’a plus la même place.
Mais ce recul historique n’empêche pas une autre réalité : notre exposition quotidienne à des images violentes n’a jamais été aussi forte, et c’est cette exposition qui façonne la manière dont on perçoit la violence aujourd’hui.
Ce décalage entre violence réelle et violence perçue est une donnée essentielle pour comprendre ce qui suit.
On le voit d’abord dans la sensibilité publique.
Les émotions surgissent toujours, parfois très fortement, mais elles s’effacent plus vite.
Le rythme du flux dépasse la capacité du regard à rester fixé.
C’est la “fatigue du jugement” dont parlait Arendt : trop d’événements graves, trop vite, trop proches les uns des autres, et le tragique perd sa densité.
On perçoit aussi un décalage générationnel.
Des images qui bouleversent profondément certains adultes apparaissent chez beaucoup d’adolescents comme de simples fragments du quotidien.
Ils grandissent dans un paysage où l’extrême n’est plus rare, où la frontière entre le choquant et le banal est plus fine.
Pas par indifférence, mais parce que leur seuil sensible s’est formé dans un monde où tout circule sur le même plan donc.
Dans certaines zones fragiles, isolement, précarité, réseaux criminels, ce glissement devient plus visible encore. On voit des adolescents très jeunes impliqués dans des violences réelles, sans avoir la moindre idée de la gravité de leurs actes. Certains tuent sur commande pour se payer des vacances à Dubai. Ce n’est pas la norme soyons clair, mais ce n’est pas non plus totalement exceptionnel. On pourrait aussi évoquer la prolifération des tueries de masse aux USA, la plupart du temps sans aucun revendication particulière.
Les images ne créent pas ces actes, mais elles modifient la distance émotionnelle avec l’extrême.
Elles rendent certains gestes moins impensables, comme si la barrière intérieure s’était déplacée.
Et puis il y a un dernier mouvement, plus diffus mais structurant : la violence devient parfois un code social. Filmer une bagarre, diffuser une agression, rejouer un geste vu ailleurs…
Pas pour célébrer la brutalité, mais pour exister dans une économie de la visibilité où tout est signe, signal, preuve.
L’image violente devient un moyen de se montrer, de compter, de marquer le territoire symbolique.
À ce stade, on n’est plus devant un simple phénomène d’imagerie. On est face à une transformation du tissu social : un monde où le tragique se dilue, où la sensibilité s’use, où les médiations collectives disparaissent, où chacun affronte seul des images qui autrefois auraient été traitées en groupe.
Ok, alors qu’est-ce qu’on fait de ça ?
COMMENT REGARDER SANS S’ÉTEINDRE ?
Alors comment vivre dans ce paysage sans perdre la capacité de sentir ?
Il n’y a pas de solution systémique simple, comme toujours.
Les plateformes filtreront toujours imparfaitement. Les algorithmes continueront de privilégier ce qui retient l’attention.
Et les images, une fois qu’elles existent, trouvent toujours un passage.
Mais on peut agir sur trois plans je crois.
D’abord, remettre du cadre là où il n’y en a plus.
Comme on l’a dit, pendant longtemps, les images violentes étaient entourées par des discussions, des institutions, des médiations.
Aujourd’hui elles arrivent isolées et fragmentées.
Prendre le temps d’en parler, même brièvement, redonne de l’air.
Ça transforme une image brute en expérience partagée, ce qui la rend moins corrosive.
Ensuite, autant que possible, protéger les plus jeunes.
Pas en interdisant tout, c’est compliqué et souvent contre-productif, au moins à partir d’un certain âge, mais en accompagnant. En expliquant ce qui relève de la fiction, ce qui relève du réel.
En posant des limites sur ce qui est vu, quand, avec qui.
En gardant un œil sur les espaces numériques où ils circulent. C’est de la protection, pas du contrôle. Parce qu’ils voient parfois des choses qu’ils n’ont tout simplement pas les outils pour interpréter seuls, et ça peut leur faire du mal.
Et puis il y a un geste individuel, discret, mais je crois important : choisir ce qu’on laisse entrer pour soi
Décider de ralentir. D’écarter certaines vidéos. De ne pas cliquer, même quand c’est tentant.
De préférer des récits qui élargissent plutôt qu’ils n’abrutissent.
C’est une hygiène mentale, une manière de garder de la place pour ce qui compte vraiment.
Personnellement, par exemple, j’ai décidé depuis longtemps de ne pas regarder de films d’horreur, de ne pas cliquer sur des vidéos d’agression, de guerre, ou simplement ces vidéos de chute à vélo, en skate, en parcours. Je consomme suffisamment d’information anxiogène comme ça, ce qui n’est déjà pas anodin sur ma santé mentale, et je n’ai pas envie que mon seuil sensible glisse encore.
Ces gestes ne résolvent pas tout.
Ils rétablissent simplement un rapport plus actif aux images.
Ils permettent de conserver une sensibilité qui, sinon, s’use dans la vitesse et la répétition.
Parce qu’au fond, tout l’enjeu est là : préserver la capacité d’être touché, préserver in fine notre capacité d’empathie.
Parce que quand plus rien ne nous atteint, pourquoi agir ?
Nos émotions sont des boussoles fragiles.
Les protéger, les entretenir, ce n’est pas de la naïveté ou de la sensiblerie, c’est une forme de lucidité.
Et dans un monde saturé d’images, le véritable acte de résistance est peut-être simplement là : garder un regard vivant, sensible, disponible à ce qui compte. Préserver notre capacité d’attention pour pouvoir faire attention à ce qui a de la valeur. La vie humaine, et tant qu’on y est la vie tout court.
Je vous laisse là-dessus.
Prenez soin de vous.
Soutenez Sismique
Sismique existe grâce à ses donateurs.Aidez-moi à poursuivre cette enquête en toute indépendance.
Merci pour votre générosité ❤️
Nouveaux podcasts
Fierté Française. Au-delà du mythe d’un pays fragmenté
Comprendre le malaise démocratique français. Attachement, blessures et capacité d’agir
Les cycles du pouvoir
Comprendre la fatigue démocratique actuelle et ce vers quoi elle tend.
"L'ancien ordre ne reviendra pas"... Analyse du discours de Mark Carney à Davos
Diffusion et analyse d'un discours important du premier ministre du Canada
Écologie, justice sociale et classes populaires
Corps, territoires et violence invisible. Une autre discours sur l’écologie.
Opération Venezuela : le retour des empires
Opération Absolute Resolve, Trump et la fin de l’ordre libéral. Comprendre la nouvelle grammaire de la puissance à la suite de l'opération "Résolution absolue".
Vivant : l’étendue de notre ignorance et la magie des nouvelles découvertes
ADN environnemental : quand l'invisible laisse des traces et nous révèle un monde inconnu.
Les grands patrons et l'extrême droite. Enquête
Après la diabolisation : Patronat, médias, RN, cartographie d’une porosité
Géoconscience et poésie littorale
Dialogue entre science, imagination et art autour du pouvoir sensible des cartes